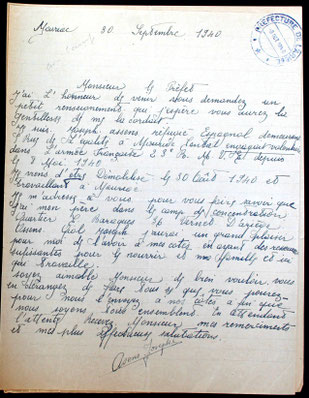DU SYNDICAT AU COMITÉ DES MILICES MILITAIRES
EN EXIL
Souvenir
de
Joseph Blas Asens-Giol
Par Joseph
de 1910 à 1937
Le texte avait été déposé après la mort de Franco au siège de la CNT de Barcelone
.
Mr Guy Assens fils de Jacques petit-fils de Joseph
résidant en Haute-Savoie et membre de l'association ERRA
Esprit de Résistance en Région Annemassienne.
a pu obtenir le texte inédit rédigé par son grand-père Joseph
nous le remercions de nous avoir confié ce document

José Asens Giol est né le 11 juillet 1900 à Porrera - Région de Tarragone . Au moment du coup d’état franquiste, le secrétaire de la FL-CNT de Barcelone et membre du Comité régional catalan. Le 17 juillet 1936, au nom de la FL et du CR, il avait fait partie avec B. Durruti de la délégation qui s’était rendu au siège de la Généralité pour y réclamer en vain la distribution d’armes. Le 21 juillet, lors du plenum régional qui suivit l’écrasement des militaires insurgés, il fut nommé avec Durruti et J. Garcia Oliver Domme délégué de la CNT au Comité central des milices antifascistes. Puis il fut le secrétaire du Comité central des patrouilles de contrôle de Barcelone et dont il fut l’organisateur avec A. Fernandez.
Le 2 avril 1938, lors de la création à Barcelone du Comité exécutif du Mouvement libertaire, il y fut nommé comme représentant de la CNT. A cette même époque il fit de nouveau un voyage à Ambilly près d’ Annemasse avec Conrado Guardiola et Mario Gallud. Plusieurs membres du réseau dont Guardiola en juin, puis Déturche en juillet 1938 furent arrêtés dans cette affaire de trafic d’armes.
Passé en France lors de la Retirada, José Asens Giol avait semble-t-il, été arrêté à Paris où il rcherchait sa famille dispersée. Transféré à Villeneuve sur Lot, il fut ensuite interné au camp du Vernet d’Ariège du 13 décembre 1939 au 11 ocobre 1941. où il fut envoyé dans une compagnie de travailleurs étrangers pour travailler au barrage de l’Aigle dans le Cantal. C’est là qu’avec un noyau de compagnons, dont J. Berruezo et José German, il participa à la réorganisation clandestine de la CNT pendant l’occupation. En novembre 1941 il était membre du Comité de relations de la CNT du barrage. Lors du plenum clandestin tenu à Mauriac en juin 1943, il fut nommé comme secrétaire du comité de relations du MLE en exil dont les autres membres étaient J. Berruezo et J. German. Son fils José Asens Valera était l’un des 75 espagnols intégré dans une compagnie du Bataillon Didier au barrage de l’aigle (voir Juan Montoliu del Campo)
José Asens Giol était marié avec Amelia Valera Lozano (née à Origuela le 16 février 1902, décédée le 15 octobre 1991) avec laquelle il eut quatre enfants :José, Conchita, Rosita et James [Jacques].
Á la Libération il militait à la Fl-CNT d’Aynes. Après la scission en 1945 du mouvement libertaire espagnol, il adhéra à la tendance dite collaborationniste. Au début des années 1970, il était membre à Seynod (Haute Savoie) des Agrupaciones confédérales qui éditaient le mensuel Frente Libertario (Paris).
José Asens Guiol est mort le 4 juin 1985 à Annecy et a été inhumé à Seynod.

Tous droits de reproduction réservés sauf accord préalable.
Todos los derechos de reproducción reservados salvo acuerdo previo.

Dans les premières années du XXe siècle, l'Espagne a vu naître une centrale syndicale qui, au fil des ans, marquera des pages glorieuses du mouvement ouvrier international dans l'histoire de nos peuples. En ce qui concerne la Catalogne, il y avait une multitude d'entreprises, déjà des coopératives ou des confréries de travailleurs, dont certaines fréquentées même par de petits employeurs, puisque le siège social était installé dans un lieu transformé en café, en salle de billard et même en table de cartes à jouer. Je citerai, à titre d'exemple, la Society of Upholsterers située dans un appartement de la rue Hospital.
J'étais très très jeune, 10 ans et quelques mois. Ayant obtenu des A à l'école primaire, mais mes parents n'ont pas pu financer l'enseignement supérieur, il n'y avait pas d'autre solution que de rejoindre les rangs de l'honorable armée prolétarienne.
Mon premier travail a été à l'hôtel Four Nations, manger et dormir à l'hôtel Puis apprenti tailleur, mangeant en famille, mais dormant sur le comptoir
Quelques mois plus tard, ils m'ont embauché comme livreur dans un établissement appelé "El colmado Simón", me chargeant chaque jour de paniers de vivres, certains pesant jusqu'à 25 kg et plus, mangeant et dormant ensemble avec la famille, profitant, si c'est le cas, on peut dire, un jour de repos tous les 14 jours, un dimanche sur deux. La pause consistait à remplir des sachets de sucre pour la distribution hebdomadaire.
Vous comprendrez à quel point les journées étaient interminables, travaillant même à huis clos, attendant d'être convoqué pour le dîner et voulant plus dormir que manger. Un jour, lors d'une conversation avec cinq des plus jeunes employés, j'ai dit qu'à part manger, à vrai dire, la nourriture était bonne et abondante, c'était un esclavage d'y travailler maison. Un vif dégoûtant est allé dire au directeur les mots que j'avais prononcés. Cela m'a valu d'être renvoyé sans autre explication, ce qui était là pour épargner.
Dans cette maison, ni dans d’autres non plus, l’employeur et le directeur ne toléreraient pas un minimum de protestation. Ils m'ont indiqué la porte de sortie pour vous. Je suis entré dans la maison et j'ai pris fin dans ces conditions de résidence dans la maison de l'employeur;
Je suis entré comme apprenti à la presse Salvat, dans la section stéréotypes. Il n'y avait qu'un seul ouvrier dans cette section, qui en peu de temps m'a appris le métier et m'a cependant exposé aux nombreux obstacles que j'allais rencontrer pour obtenir un poste permanent dans ce métier, à moins d'avoir la chance d'être placé dans un journal. .À différentes occasions, je lui avais expliqué que mon souhait était d'être tapissier comme mon père.

A cette époque, je gagnais 17 pesetas par semaine et comme mon père s'était toujours opposé à ce que j'apprenne son métier, ce brave homme m'a proposé d'aller chercher du travail dans un atelier de rembourrage; Et pourtant c'est que quand je suis devenu apprenti dans ce métier je gagnais un maximum de 8 pesetas par semaine pour entrer, le gentil M. Isidro m'a proposé de me donner les 9 pesetas pour terminer les 17 afin que ma maison ou ils sachent que j'avais changé d'emploi. Je lui avais expliqué qu'ayant regardé mon père travailler, je me sentais capable, en peu de temps, de gagner comme apprenti avancé. Trois mois m'ont suffi pour obtenir un salaire de 17 pesetas par semaine, ce qui été établi par la Upholsterers 'Society, les employeurs devaient payer les apprentis avancés. Comme si cela avait été prédit par moi, à cette date, mon père a été informé par un collègue que je travaillais comme apprenti tapissier dans un atelier de la rue Rosellón.
A cette date, si mémoire est vraie, une grève des ébénistes avait été déclarée et la fin de la grève coïncidait avec la nomination de mon père à la présidence de la Upholsterers Society, qui à l'époque avait été établie dans un appartement de la Plaza Real
Lors de la première réunion qui s'est tenue à cet endroit, il y avait un point à l'ordre du jour qui disait: "Est-il nécessaire de se dissoudre en tant que société et de rejoindre l'union du bois unique?"Enfin, l'accord prévoyait que le président prenne les mesures nécessaires pour rejoindre la C.N.T.
J'étais très jeune à l'époque, mais j'étais plus ou moins conscient de ce qu'étaient les luttes sociales et politiques. Ce que j'ai appris, c'est des conversations entre mon grand-père et mon père. Aucun n'appartenait à aucun groupe politique et ne souhaitait pas voter dans un collège électoral. De leurs conversations, j'ai appris ce qui s'est passé dans ce qui est connu dans l'histoire noire de l'Espagne comme "la semaine tragique" de 1909 et sur les interventions dans les luttes politiques des charlatans Alejandro Lerroux, Emiliano Iglesias, Marcelino Domingo, Cambo et compagnie. De l'attitude des gouvernements de l'époque, surtout Maura, responsable de l'exécution de Francisco Ferrer u Guardia, ainsi que Carbonero, un pauvre innocent trahi d'avoir dansé avec une momie prise au couvent. En 1916, j'ai obtenu la carte confédérale en tant que contributeur au Syndicat du Bois, le plus dynamique de ceux qui appartenaient à la Fédération locale des syndicats de Barcelone.
J'étais très intéressé à en savoir plus sur le fonctionnement du syndicat auquel j'appartenais, qui était situé rue del Rosal, dans le quartier Pueblo Seco. Là, j'allais deux ou trois jours par semaine pour assister aux réunions des travailleurs de différents ateliers, qui étaient convoquées quotidiennement. J'ai assisté à des réunions en tant qu'observateur et je me sentais comme un futur militant qui chaque jour mettait plus d'intérêt à participer en tant que tel à la défense des travailleurs, comme le faisaient à l'époque les militants syndicaux les plus connus, comme Salvadoret , Alboricias, Vidalet, Sanmartín, Espagne et autres compagnons dévoués.
Dans les années 1916-1917, il y eut une grève générale qui fut le début de grandes luttes sociales. L'atmosphère était très favorable car il y avait beaucoup de travailleurs en Espagne, à laquelle s'ajoutait une inflation galopante des produits alimentaires. Les causes en étaient nombreuses, mais surtout celles dérivées de la guerre de 1914-1918 influencées. Les protestations ouvrières ont multiplié, ainsi que les rassemblements, les interventions de la police à l'issue des réunions, qui étaient avant tout des provocations pour justifier les arrestations de militants.

Deux brigades de police se sont distinguées dans ces provocations: celle de Bravo Portillos, abattu plus tard, et celle d'un certain Martorell, que nous appelions «Los Matalases». Ces individus avaient pour mission de procéder à des arrestations et des persécutions, de s'appuyer sur la plus forte des organisations ouvrières, qui a toujours été la C.N.T. Les années après 1917 furent cruelles pour la classe ouvrière. Le C.N.T. elle a été condamnée à la clandestinité permanente, avec l'aide de l'État.
Le Fomento del Trabajo a organisé «Los Somatenes», dont la Ligue régionaliste avec Cambó, Beltrán et Musitu et des employeurs généralement bien armés faisaient partie, tous sont devenus des mouchards de la police. Ces messieurs - pour ainsi dire - du Département du développement, ont tout fait pour démoraliser les puissants confédérés, du pacte de la faim appelé «lock-out» à l’organisation des soi-disant syndicats libres, composés de voyous bien payés, de briseurs de grève et d'autres êtres méprisables, qui ont ensanglanté Barcelone et d'autres villes de Catalogne, avec le meurtre de dignes ouvriers dont le seul crime était de défendre leurs collègues exploités au travail et persécutés pour avoir lutté contre l'exploitation d'une humble bourgeoisie.

Cette série d'attaques contre le C.N.T. Cela a duré en principe de nombreuses années, prenant de nouvelles formes répressives lorsque l'ambitieux général a attaqué très durement tout ce qui avait la couleur de la liberté, fermant les syndicats, les athénées et les centres culturels, et a ouvert des prisons et des prisons, mettant les forces aux commandes. répressif aux généraux du même acabit. Des êtres répulsifs que furent les généraux Martínez Anido et Atlegui, la Catalogne gardera pour toute sa vie un souvenir triste et déplorable: la loi des évasions, les déportations, la torture dans les cachots des sous-sols de la préfecture de police ...
Toutes les forces réactionnaires de La droite et le centre, unis à des peuples mal nommés de gauche, formaient un bloc pour empêcher l'avancée du prolétariat espagnol, et en particulier du Catalan, qui était le plus cruellement combattu. Plus tard, les Dancás et Ba......., avec des groupes armés créés par eux, appelés les Escamot, sont venus occuper des positions élevées en Catalogne. Ce «veau» a duré peu de temps; le bon pour jeter les armes qu'ils possédaient dans les égouts de Barcelone, rassemblés, mais pas tous, par ceux qui serviraient un jour à se défendre contre la réaction. -------------- Les mois et les années suivirent. Le C.N.T
Il recevait des coups plus durs, car l'ouvrier, dans sa lutte pour obtenir de simples améliorations, avait pour seule ressource la grève, une arme de lutte de tous les temps. Les employeurs n'ont pas augmenté les salaires de ceux qui engraissaient les coffres-forts de leur plein gré.
Comme il n'y a pas de règle sans exception, je dirai que j'ai travaillé dans un atelier où nous n'étions que trois ouvriers - un ébéniste, un vernisseur et moi-même - qui savions par cœur cela le jour de Sant Antoni - comme l'appelait le patron - et Le jour de Sant Josep, une fois la journée terminée, et pas avant, le patron du fouet nous a donné un tortell de dix réaux et un litre de muscat - au total, cela valait 4,50 pesetas. Comme notre patron était généreux!Il ne fait aucun doute, cependant, que pour obtenir des améliorations, des grèves ont eu lieu dans différents ateliers et métiers, et les employeurs, les autorités catalanes et le gouvernement, toujours d'un commun accord, ont préféré la répression systématique contre les travailleurs à la discussion sur la est à l'origine du mécontentement des ouvriers, ce qui revient à dire des producteurs en général.
Dans ce contexte, pas un seul jour ne s'est passé sans que la police n'agisse de force contre les locaux d'un syndicat, récupère tous les exemplaires de Solidaridad Obrera dans les kiosques, ou ferme les presses à imprimer, les écoles et les centres culturels. Cette situation clandestine a duré des semaines, voire des mois. Heureusement, les militants du C.N.T. Ce sont des hommes d'acier et lorsqu'ils ont essayé de défendre la cause des ouvriers, ils multiplient leurs forces et ne reculent devant aucun danger. Ils en ont fait la preuve à plusieurs reprises. Il n'était pas possible de se réunir en groupe pour conclure des accords, les locaux du syndicat étant fermés pour les réunions locales, départementales et régionales, nous trouvions toujours un endroit pour les tenir, que ce soit dans l'un des bovilas du quartier des Corts, en un sous-sol d'une usine avec l'assentiment du gardien de nuit, et généralement dans ces magnifiques forêts de La Floressta, où le parfum et la sauge des pins renforçaient notre moral.
Les réunions en forêt étaient généralement les plus importantes en nombre de participants, aussi parce que les accords à conclure étaient urgents et d'un grand besoin pour l'organisation confédérale. Pour dire la vérité, il n'y a jamais eu de revers ou d'incidents dans les très nombreuses réunions que nous avons tenues. Les personnes convoquées ont été informées du lieu de rencontre au moment précis et par un autre canal. Qu'est-ce que dans le C.N.T. il n'y avait pas d'informateurs de la police? Très peu! Je ne citerai pas les noms de ces êtres dégoûtants, car ces êtres ne sont pas nommés. Tous ceux qui ont été découverts ont payé cher leur trahison.
Si dans l'une des réunions un accord a été conclu pour déclarer une grève, partielle ou générale, celles-ci ont été effectuées préalablement annoncées au moyen de manifestes ou d'affiches collées dans des endroits bien visibles du centre de la ville et des quartiers, car il n'y a jamais eu de manque de militants dévoués. qui étaient occupés à le faire la nuit. En principe, le C.N.T. Il n'y avait pas besoin d'écoles militantes, puisqu'elles étaient formées à la lutte quotidienne contre leurs oppresseurs et acquéraient de l'expérience en étant victimes de répression et d'emprisonnement.
Si la période de secret posait des problèmes à la CNT, tels que des irrégularités dans les cotisations et une désorganisation des travailleurs au sein de l'atelier ou de l'usine, elle présentait également des inconvénients pour les employeurs, car la police intervenait moins et le délégué de l'atelier devait être impliqué. prendre en charge la résolution des problèmes les plus graves, comme une grève surprise. C'est pourquoi le C.N.T. clandestinement, cela représentait un plus grand danger pour les autorités, notamment parce qu'elles ne pouvaient pas être informées par leurs confidents, qui fréquentaient les syndicats lorsque leurs locaux étaient légalement ouverts.
J'ai été arrêté pour la première fois en tant que militant, à vrai dire pendant quelques heures, mais avec beaucoup de chance, car cette nuit-là était un très triste souvenir pour le C.N.T. Dans la rue d'Entenza, sur le chemin de la prison de Modelo, de bons collègues ont été assassinés par la police. Le rapport de police disait: "Lorsque certains prisonniers ont tenté de s'échapper, la police a été forcée de tirer pour intimider les fugitifs, avec une telle malchance pour eux que les coups de feu ont causé leur mort." Les malheureux camarades avaient été arrêtés à sept heures de l'après-midi dans le café du théâtre espagnol. Boal, secrétaire du Comité national de la C.N.T., a été l'une des victimes. Comment et pourquoi ai-je été arrêté? J'ai travaillé en compagnie de mon père dans un petit atelier situé dans une ruelle près de la cathédrale, une ruelle qui a aujourd'hui disparu en raison de la rénovation de la partie ancienne de la ville. Les employeurs du magasin étaient deux, un Escorza (un socialiste!) Et un Bonet, qui se disait sympathisant anarchiste.
Rue Puertaferrisa Barcelone
Le différend idéologique était permanent entre les deux, mais en matière commerciale, ils se comprenaient bien. En fin de journée, mon père et moi nous dirigions vers la rue Puertaferrisa et vers le coin du Duque de la Victoria, nous avons vu un collègue nommé Coll. Cela faisait plusieurs mois que nous ne l'avions pas vu, et lorsque nous l'avons salué, nous avons compris que quelque chose de grave lui arrivait. En effet, elle attendait que la pharmacie fabrique ses médicaments pour son fils gravement malade. Le pharmacien lui avait dit qu'il allait devoir attendre environ une heure. Il est à noter qu'à ce moment-là, le médecin prescrivait la formule et le pharmacien se remettait juste à attendre dans la pharmacie le temps nécessaire pour payer.
Revenant sur le récit de l'arrestation, il faut ajouter que comme ledit compagnon a dû attendre longtemps là-bas, il nous a accompagnés en direction des Ramblas, et nous venions de marcher une vingtaine de mètres, lorsque deux hommes qui venaient du front se sont séparés, un de chaque côté de la rue pour nous faire place. Cette attitude nous a paru suspecte, et quand nous sommes arrivés à Las Ramblas, mon père nous a dit: Descendons.

Et quand il est arrivé au
théâtre Liceu, il a dit: Faisons demi-tour. Avec surprise, nous avons vu que ces individus nous suivaient à quelques mètres environ. J'ai remarqué que l'un d'eux avait une grosse coupure sur la joue gauche. C'était, sans aucun doute, l'un des tueurs à gages de la police du soi-disant Syndicat libre, qui s'appelait «le Tallat». Nous avons continué à remonter la Rambla, et à la hauteur de la rue Puertaferrisa, nous avons été tenus sous la menace des armes de ces individus, qui étaient accompagnés de deux policiers des soi-disant «gardes de sécurité», qui gardaient Las Ramblas.

Ils nous ont fait entrer dans la cour d'entrée du Palacio del Marqués de Comillas et là ils nous ont attachés tous les trois, nous disant que si nous ne nous étions pas dirigés vers les Ramblas, leurs pistolets auraient été ceux qui nous auraient arrêtés. Celui qui accompagnait le Tallat était un autre voyou rongé par la variole, connu sous le surnom d'El Grabat. Ils nous ont fait marcher en direction de la préfecture de police et par hasard nous avons croisé l'un de nos patrons, qui partait toujours trois quarts d'heure après nous et qui se rendait aussitôt chez nous. Là, il a trouvé mon partenaire, qui a immédiatement pris de chez lui tout ce qui pouvait prouver mon appartenance au C.N.T. Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'Organisation confédérale se cachait et les garanties constitutionnelles étaient suspendues. En Catalogne, un état de guerre a été décrété, nous y étions donc déjà habitués, produit de la monomanie gouvernementale.
Au quartier général de la police, ils nous ont fait déclarer l'adresse et les policiers s'y sont immédiatement rendus, dans le but de faire la fouille habituelle. Notre adresse a donc été fouillée, armoires comprises, sans aucune ordonnance du tribunal. Notre collègue en détention vivait dans une caserne située au bout de la rue Conde del Asalto, un endroit un peu dangereux pour les policiers, surtout s'ils se présentaient la nuit. Il est certain que les agents désignés pour enregistrer notre confrère avaient trouvé une fausse adresse. Ainsi, un policier est descendu au calbozo et a emmené Coll et, une quinzaine de minutes plus tard, la porte a été rouverte.
Nous pensions qu'ils nous amenaient un nouveau détenu, en fait, de notre partenaire méconnaissable après les terribles coups qu'ils lui avaient infligés pour avoir donné une fausse adresse. Et comme à chaque fois qu'ils lui demandaient où ils habitaient, il donnait la même fausse adresse, les coups contre notre partenaire étaient plus grands à chaque fois. Le lendemain, d'ailleurs très tôt, les policiers ont fouillé la maison de Coll. Ils n'ont rien trouvé qui puisse le compromettre et, de plus, ils ont vérifié qu'il était bien vrai que son fils était malade; mais personne n'a ôté de son corps les coups terribles qu'ils lui ont infligés la veille.
Mes employeurs, qui connaissaient mes activités au C.N.T. Et ils n'ignoraient pas le danger que représentait leur arrestation en ces jours sombres où la terreur policière et la loi pénale sur l'évasion régnaient à Barcelone, ils se sont rendus au quartier général de la police, accompagnés d'un avocat, pour demander notre liberté. Finalement, cela nous a été accordé sans que nous n'allions jamais en prison. Le fatidique général Arregui m'a dit que si nous avions été détenus, c'était parce qu'un policier avait confondu notre collègue Coll avec un militant du syndicat de la construction nommé Tarag? Surnommé "El Patillas". En effet, Coll avait l'habitude de porter des favoris jusqu'au milieu de la joue. Alors, quand notre avocat nous a dit la raison de notre arrestation, j'ai immédiatement pensé aux mots que «el Tallat» nous avait dit, faisant référence au fait que nous étions sauvés de la mort en nous dirigeant vers les Ramblas. Ceux qui n'ont pas vécu cette époque de près ne peuvent se faire une idée de ce que la répression subie par ceux d'entre nous qui se sont battus pour un meilleur respect des travailleurs des ateliers et des usines, et une vie meilleure, puisque l'homme ne vit pas que de pain

Pour ceux qui ne travaillent pas, mais vivent en exploitant le prolétariat, les ouvriers sont un objet, un moyen de remplir leurs comptes à la banque et de posséder des maisons et des palais, en plus de pouvoir donner tout le confort et les goûts à leur palais. Le C.N.T. c'était un danger pour eux et ils voulaient le détruire, le faire disparaître. Pour arriver à ses fins, tous les moyens étaient bons: emprisonnement, révocation, déportation, menaces et assassinats.Toutes les régions d'Espagne étaient ensanglantées, et avec plus de cruauté la Catalogne, où il y avait une bourgeoisie égoïste et envieuse, qui utilisait toutes les procédures, même les plus inhumaines, pour empêcher la classe ouvrière de rejoindre les rangs de la C.N.T. - une organisation qui se renforce chaque jour - a obtenu des améliorations dans les conditions de travail des usines et des ateliers. Depuis 1919, année de la déclaration d'une des grèves les plus importantes et les plus répandues - La Canadiense -, d'autres grèves sont déclarées. Beaucoup d'entre eux se sont d'ailleurs succédé dans les années suivantes.

Dans
presque tous, des améliorations ont été obtenues que l'Association des employeurs, bien que bien organisée et bien protégée par les organismes répressifs de l'État, a été forcée d'accorder, non
sans sacrifier le militantisme confédéral, dont les militants ont été emprisonnés et torturés dans les sous-sols de la quartier général de la police et dans les postes de police de district.De
1923 à 1930, l'Espagne a connu deux dictatures, le Primo de Rivera et le Berenguer, deux généraux aux tristes souvenirs qui ont utilisé d'autres généraux -Martínez Anido et
Arlegui- pour satisfaire les desseins criminels des capitalistes et de la classe patronale des Strangulation du C.N.T., faisant revivre en Espagne la période des Torquemadas, des marchands
d'esclaves et du caciquismo.
Du plus simple activiste de la CNT, comme moi, aux plus dynamiques, nous étions opposés à l'objectif patronal de détruire l'organisation confédérale, nous en avons tellement qu'il est impossible de les nommer tous, par tous les moyens dont nous disposions. .
L'Organisation a toujours résisté aux attaques du capitalisme et de ses défenseurs."Défendez-vous, défendez-vous toujours", était le slogan imposé par tous les militants de la C.N.T., y compris les anonymes, comme le raconte Simo Piera dans "Records i experiences d´un leader de la C.N.T." Plus tard, je parlerai du fait qu'il n'a jamais eu le C.N.T. dirigeants. Oui, de nombreux honnêtes travailleurs sont tombés, dont je dois mentionner certains de ceux que je connaissais bien dans l'Union du bois, tels que Salvadoret, Albricias et d'autres. Il est impossible de se souvenir de tous, autant de victimes de la réaction. Les ordres de répression venaient d'en haut et d'en bas. Ils venaient des ministères de l'intérieur. A cette époque, ils venaient de celui qui était gouverneur civil de Barcelone
Le massacre de Casas Viejas désigne les événements qui se sont déroulés entre les 10 et 12 janvier 1933 dans la petite ville de Casas Viejas (province de Cadix) en Espagne.
d'un certain Laborda, de celui de Bilbao, d'un certain Régueral, et du cardinal Soldevila. Ah, mais beaucoup ont eu la fin qu'ils méritaient, même si certains ont échappé à la vengeance des militants anonymes de la C.N.T.! DEUXIÈME RÉPUBLIQUE Ainsi huit années de luttes sanglantes se sont succédées, qui nous ont semblé s'achever avec l'avènement, en 1931, de la Seconde République, appelée aussi par certains «République ouvrière». La vérité est que c'était une république de républicains qui venait du champ monarchique ou qui avait collaboré avec la dictature éteinte. De tous, il y avait parmi les dirigeants de ce régime, moins de travailleurs. Il y avait même un président, Azaña, qui a ordonné des "coups de feu au ventre" lors des événements de Casas Viejas, le village martyr andalou. L'épreuve ouvrière ne s'est pas terminée, comme on le supposait et on l'espérait, avec l'avènement de la République

Le jour où cela a été proclamé, je vivais à Vallcarca, où vivaient également mes parents et mes grands-parents. J'étais avec mon père ce jour-là au syndicat du bois, situé à Pueblo Seco. Il y avait déjà des nouvelles de ce qui s'était passé Il y aurait des événements à Barcelone, nous sommes rentrés chez nous pour manger et sortir les armes de notre cachette, puis retourner au centre de Barcelone. Mon grand-père voulait venir avec nous, mais nous l'avons convaincu de ne pas nous rejoindre. Il nous a dit: "J'espère que vous prenez des précautions pour ne pas subir d'accident personnel ou être arrêté."La République a été proclamée en Catalogne sans lutte armée, sans coup de feu, avec le silence total des armes. À l'aube, nous sommes retournés à Vallcarca à pied. Mon grand-père était sur le balcon et nous a vus arriver. De chez nous, tout Barcelone était dominée. Pendant qu'il nous faisait du café, nous lui avons expliqué tout ce qui s'était passé l'après-midi et la nuit de cette journée. Sa réponse a été: "La musique et les chansons d'aujourd'hui deviendront des drames et du sang dans le futur." Mon grand-père avait raison, qui a ajouté: "Je ne le verrai pas à coup sûr." En effet, il mourut en janvier 1933, mais vécut deux ans de cette République, né après les années de terreur vécues par le peuple espagnol

Lorsque l'attaque de Salvador Segui - "El Noi del Suere" - a eu lieu dans la rue de la Cadena, il a perdu la vie, en 1923, j'étais à vingt pas, ce qui m'a permis de distinguer l'individu par derrière. qu'il a tiré cinq ou six fois avec son pistolet sur un homme qui se trouvait au milieu de l'intersection de la rue à San Rafael. Je me souviens que le meurtrier était vêtu d'un imperméable de couleur claire. J'ai tout de suite su que celui sur le terrain était le Noi del Sucre. Quelques instants après l'attaque, le camarade Gardeñas est apparu, à qui j'ai expliqué et expliqué comment l'attaque s'est déroulée et en détaillant la silhouette et les vêtements de celui qui a tiré, il s'est exclamé: «On a fait face, l'assassin!» Et a ajouté avec indignation: nous te vengerons "Nous connaissions personnellement Gardeñas depuis longtemps. Avec lui, nous sommes allés à Sant Feliu del Llobregat, où vivait un collègue que nous appelions «El Nanu». Avec lui, qui connaissait très bien ces arbres fruitiers de cette ville - pourquoi le nier -, nous sommes allés à la "sortie" des fruits.
A notre arrivée chez lui, nous les mettions dans deux grands paniers, et avec le car de Barcelone nous descendions à la Plaza de España. À pied, nous sommes allés à la prison de Modelo au moment de la visite, car il y avait toujours beaucoup de codétenus ou de parents à qui nous distribuions les fruits et ensuite nous avons discuté longuement avec eux. Après le meurtre de Segui, Gardeñas est rentré à la maison plusieurs fois. Je savais que ma compagne, que je connaissais pour l'avoir vue pour la première fois le jour de l'attaque, avait donné naissance à ma deuxième fille, Rosita. Nos conversations se référaient toujours au jour de l'attaque et de la mort du Noi del Sucre, dont ma partenaire, Amelia, a été témoin de la même chose que moi.
Avec Gardeñas, j'ai été arrêté dans l'un des nombreux raids que la police a effectués dans le café mal nommé "La Tranquilida", situé dans le Parallèle. Ce café n'a jamais été à la hauteur de son nom, car ses clients réguliers, même ceux qui prenaient une boisson gazeuse à l'une de ses tables, ont été exposés à être conduits par la police à la délégation d'Ataranzas, où ils ont été insultés et maltraités, tels que cela m'est arrivé cette fois. Il en était de même pour Gardeñas, et plus durement que moi, puisqu'il était inscrit dans cette délégation.
J'ai alors été réservé pour la première fois, et comme au moment de l'arrestation nous étions tous les deux assis à la même table, ils ont mis «prétendu dangereux» dans mon dossier. J'ai ensuite passé quinze jours en prison, la soi-disant «Quinzaine» sans doute parce que les patrons de l'atelier où je travaillais à l'époque, faisaient de bons rapports sur ma conduite. Gardeñas, pour aucune autre raison que d'être réservé, a subi une détention plus longue. Depuis cette date, sans doute en raison d'avoir retrouvé au moment de son arrestation la carte de la Wood Union, considérée comme la plus active des C.N.T. A Barcelone et aussi pour avoir été arrêtée avec Gardeñas, la police a perquisitionné et fouillé la maison de mes grands-parents, c'est-à-dire la maison où ils étaient porteurs, et dans laquelle j'occupais une chambre avec ma compagne. Toujours dans la rue, mon grand-père a observé depuis le kiosque, (DU GARDIEN DE BUT ??) à l'intérieur duquel il travaillait comme cordonnier, les allées et venues de types suspects, tous regardant dans le kiosque. Mes grands-parents étaient là comme gardiens de but depuis 25 ans, à tel point que je suis né dans cet objectif.
Cependant, en ces temps que je raconte, ils étaient très préoccupés par la froideur qu'ils observaient chez certains occupants des étages de cette maison lorsqu'ils passaient devant le kiosque, concluant que, sans aucun doute, une telle attitude était due au fait que lesdits voisins avaient été témoins de certains des les perquisitions que la police avait effectuées dans les chambres des portiers, situées à gauche et à droite de l'entrée principale de la maison. Coïncidant avec la date à laquelle certains voisins avec lesquels nous avions beaucoup d'amitié, allaient déménager à Tarragone pour reprendre une propriété dont ils avaient hérité, située dans le Prieuré, d'ailleurs, tout près de Povaleda, une ville très proche de celle où il est né.
Ma mère -Possera- et chez qui j'avais passé une partie de ma jeunesse, nous avons décidé en famille de partir avec eux pour nous éloigner de Barcelone pendant un certain temps, et à notre retour, de quitter notre maison de la rue Sepúlveda. La propriété dont je viens de parler, ainsi que la ferme, étaient situées dans la municipalité de Povaleda, en contrebas de l'autoroute, touchant la rive de la rivière Ciuraba. Nicolás, qui était le nom de notre sympathique voisin de la rue Sepúlveda, était bien connu dans la région.
Amelía et moi nous y sommes installés, ainsi que Pepito, l'un de nos fils, qui, 16 ans plus tard, participera à la lutte contre les rebelles à Barcelone alors qu'il était très jeune. En faisant un autre saut dans notre histoire, je dirai que notre arrivée là-bas a eu lieu en septembre, et que deux ou trois jours plus tard, nous avons reçu la visite d'un couple de la Garde civile. Ils ont dit que c'était seulement pour accueillir les nouveaux arrivants à la fin de la Povaleda. Ils n'ont pas été surpris par notre présence dans la ferme. En tout cas, Nicolás leur a dit que nous étions là pour des raisons de santé. Après une petite conversation, parlant de la pluie et du beau temps, ils ont exprimé leur intention de venir passer une journée à chasser et à manger du bon riz. Ils allaient à Cornudella, mais tous les jours je passais par là (la ferme).
Dix jours plus tard, ils sont venus chasser comme ils l'avaient prévu. Ils ont enlevé leurs tuniques, et dans le corps d'une chemise, nous sommes allés chasser tous les quatre. J'avais un permis de chasse depuis l'âge de 18 ans, mais mon fusil de chasse est resté à Barcelone. Nicolas m'a dit que l'un des gardiens avait un chien de chasse, ce qui nous manquait. Dès que nous nous sommes dispersés, nous étions à environ 100 mètres de la ferme, je me suis rendu compte que des fenouils qui étaient à dix mètres de moi se déplaçaient en traçant un chemin. J'ai remarqué que c'était un lièvre. De la route, j'ai appelé Amelia, qui est venue tout de suite et a emmené le lièvre à la ferme, car elle ne pouvait pas continuer à chasser avec ce poids sur elle. Ensuite, nous avons fait sauter un troupeau de perdrix dont nous avons pu en tuer cinq. Il était 11 heures du matin et nous avons arrêté de chasser. Les femmes ont préparé le riz et après avoir mangé, elles sont parties en nous disant: "Nous vous reverrons dans dix jours". Le lendemain, je me suis levé tôt pour aller chasser, quand d'un monticule, de l'autre côté de la rivière, j'ai distingué deux silhouettes qui avançaient à grands pas le long de la route qui mène à la Masía. J'ai bien distingué le scintillement des tricornes, et en effet, lorsqu'ils ont atteint le niveau de la maison, ils se sont mis sur le chemin qui y menait, mais comme c'est que la veille je Ils avaient dit "dans les dix jours", j'imaginais qu'il se passait quelque chose de nouveau. De sous un noisetier, j'ai vu les deux tricornes gesticuler avec Amelia et Nicolás. Au calme, je contemplai les gestes que tous les quatre firent pendant une heure et demie. Plus tard, Nicolás les accompagna sur la route, parlant toujours. Quand ils s'étaient éloignés à environ 800 mètres de la maison, je me suis approché et j'ai dit à Nicolás, sans avoir à expliquer ce qui s'était passé, que j'étais sûr qu'ils venaient pour moi. Et ils l'étaient, comme ils m'ont confirmé. Quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont dite à Amelia, avec tout le visage dur, et sans tenir compte du fait que mon fils allaitait, était: "Regardez madame, hier nous mangions exactement et aujourd'hui nous sommes venus arrêter son mari." Nicolás les a interrogés: "Pour quelles raisons?" "Pour être un anarchiste dangereux, et il nous semble aussi qu'il est un fugitif", a déclaré le caporal.

Dans ce dernier, ils avaient en partie raison. Cependant, je n'ai jamais pu savoir d'où venait la plainte, même si je m'en doutais. En ce qui concerne l'anarchiste, en fait, étant libertaire comme moi, je n'ai jamais appartenu à la F.A.I., dont j'ai toujours été un sympathisant. Au cours de la conversation avec les agents, Nicolás, ignorant que j'avais assisté de près à cette manœuvre des gardes civils et craignant d'y apparaître soudainement, leur a dit: C'est un faux rapport, et vous perdez votre temps ici. , parce qu'il est parti avec des provisions pour passer la journée à chasser. Je vous promets que lorsqu'il arrivera, même s'il est tard, je descendrai en ville avec lui et ils seront convaincus qu'il s'agit d'une fausse plainte. "La franchise de Nicolás les a convaincus et ils sont partis. Quand Nicolás m'a raconté ce qui s'était passé, je lui ai dit: "Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous accompagner à la caserne de la Garde civile." "Non", m'a dit Nicolás, "je n'allais pas tenir la parole que je vous ai donnée." "Alors" - répondis-je - "prends le vélo, va à Cormudella et envoie un télégramme disant: << Le garçon est très malade. Continuez votre chemin. Je t'attendrai à Porrera. >> " Je me suis immédiatement rendu là-bas, chez certains de mes oncles, où mon père est arrivé, qui a loué à Reus une tartana qui l'a emmené de Reus à Porrera et avec elle nous avons fait le chemin et nous nous sommes installés à l'auberge de Bou pour dîner et passer la nuit.
Nicolás est allé en retard à la caserne de la garde civile et a dit, chef de poste: "Écoutez, il m'était impossible de vous faire venir avec moi, j'avais confiance en votre parole." Le caporal a répondu: "Maintenant, il faudrait que je vous arrête." "Eh bien, fais-le," répondit Nicolás, "je ne pouvais pas l'amener ligoté." «Allez-vous-en», répondit le caporal.
A Reus, deux attentats avaient eu lieu ce jour-là contre deux hommes armés du Syndicat libre et la gare était donc très étroitement gardée. En raison de ces circonstances, nous avons chacun acheté les chemisiers noirs que les éleveurs portent habituellement les jours de foire aux bovins. Mon père a acheté une canne aussi, et ensemble nous sommes allés à la gare. Nous avons vu là-bas deux types qui étaient sans aucun doute des policiers. Je me suis assis sur un banc et mon père est allé chercher les factures. Personne ne nous a dérangés ou interrogés. En arrivant à Barcelone, le train s'est arrêté quelques minutes avant d'entrer en gare de Sants, attendant que le disque soit abaissé et cédé. Mon père et moi avons profité de ces minutes pour descendre. Je suis resté dans le quartier de Sants avec une belle-sœur qui vivait dans la rue Conde Bell-Lloch.
Je ne sais pas si nous voyagions dans le même train, même si c'est tout à fait possible; la vérité, en tout cas, c'est que le caporal est arrivé rue Sepúlveda avant mon père. Il est arrivé habillé en civil et a demandé: "Êtes-vous la mère d'Asens?" "Non, je suis sa grand-mère." «Je viens de Povaleda avec son petit-fils dans le même train. Je suis voisin de Nicolás. Son petit-fils, qui en descendant du train est allé faire des courses, m'a dit: «Va chez mes grands-parents - première offense, car il croyait que ma grand-mère était ma mère - et nous mangerons ensemble». "Ah," lui dit ma grand-mère. «Vous vous asseyez et l'attendez. Ma grand-mère était au courant de l'envoi du télégramme et comme le type ne partait pas, elle lui a dit: "Votre visite, monsieur, me semble très étrange." Ce à quoi il répondit: "Vous êtes une dame très mignonne, et quand votre petite-fille viendra, elle vous dira que le cap Povaleda était là."«Je n'aurai rien à lui dire, car il ne viendra pas, alors sors de chez moi. Le costume que vous portez ne ressemble même pas à des tiges. " Quelques jours plus tard, Amelia est arrivée avec l'enfant, et nous nous sommes installés comme locataires dans la maison de quelques amis de la rue Fernandina temporairement, puis à La Torrasa en permanence.
Là, en compagnie de plusieurs collègues, nous avons définitivement constitué l'Athénée Libertaire de Holland Street. PARLE ENCORE DE LA RÉPUBLIQUE Nous étions déjà dans la République ouvrière, dont mon grand-père a dit que cela coûterait cher de l'avoir amenée ainsi accompagnée de musique et de chansons. Beaucoup de sang a prédit mon grand-père pour l'avenir, comme c'est arrivé. La même République qui a laissé Alfonso XIII quitter l'Espagne bien protégée. Il n'était pas, à vrai dire, un roi despotique, mais il a permis aux gouvernements qui se sont succédé sous son règne de commettre de multiples outrages contre le peuple, et surtout contre la classe ouvrière, et a soutenu l'arrivée des dictatures de Primo de Rivera et Berenguer, ainsi que ceux qu'ils mettent comme gouverneurs et chefs de police dans les différentes régions d'Espagne des individus sans scrupules, tels que les généraux Anido et Arlegui, et d'autres qui, sans être généraux, ont fait couler tant de sang en Espagne. Alfonso XIII était très enthousiaste à l'idée d'organiser et de participer à de grandes chasses, dont la plupart étaient menées dans les grandes propriétés des plus riches, les caciques de Castille et d'Andalousie.
Cette façon de s'amuser lui a semblé une nécessité essentielle, pour mieux gérer les intérêts des gens. Grand enthousiaste aussi et d'accumuler des capitaux, d'acquérir des propriétés et des parts dans les mines du Rif d'autres grandes exploitations. Bien que ce que je commente n'ait rien à voir avec ma performance dans les luttes sociales, cela fait également partie de mes souvenirs de jeunesse. Déjà dans les derniers jours de la dictature, Primo de Rivera, l'une des nombreuses chasses qui ont eu lieu à Cataunya a eu lieu sur la propriété appartenant au Marqués de Marianao, dans la municipalité de Cambrils, appelée Parque Sondá.
J'avais commencé à y travailler trois semaines auparavant, pour réparer et remettre en bon état des rideaux et des fauteuils dans les différentes pièces et pièces du palais. UNE ORGIE ARISTOCRATIQUELa chasse devait assister entre quarante et cinquante invités, les plus sélectes de la soi-disant aristocratie de Barcelone. Après la chasse, Alfonso XIII, Dona Victoria et les bébés sont partis pour Montserrat. Le marquis de Marianao retourna à Barcelone à sa résidence sur le Passeig de Gracia, après avoir donné une grande quantité de gibier aux religieuses de Reus et de Tarragone, qu'elles transportèrent avec une camionnette qui les attendait pendant qu'elles chassaient. Les invités y restèrent, et après le souper, ils eurent tout le service, c'est-à-dire que les domestiques et les bonnes se retirèrent dans leurs chambres. La grande fête a commencé. J'en ai été témoin en compagnie du chef des locataires, ce grand domaine dans lequel ils m'ont logé pendant mon séjour là-bas. Une fête aristocratique a eu lieu dans la salle à manger grandiose, que l'on pouvait voir à travers les volets d'une des fenêtres, à laquelle manquait une tablette.
Comité des milices anti-fascistes de Catalogne

Ce que j'ai vu, je m'abstiens de commenter pour éviter que ceux qui lisent ces mémoires doutent de ce que je dis et de la sincérité de mes paroles. J'avais lu pas mal d'orgies et de danses roses et bleues, et c'est alors que j'en ai été témoin en direct pour la première fois. Avec ou sans la République, la classe ouvrière a dû continuer à se battre pour des améliorations et plus de respect sur le lieu de travail, et avec plus d'efforts, surtout parce qu'après sa proclamation, des augmentations des nécessités de base apparaissaient chaque jour et dans les vêtements et chaussures ... etc La C.N.T., arme de défense des ouvriers, a commencé à se mobiliser pour obtenir des patrons des améliorations pour les ouvriers, tant économiques que moraux; mais ces améliorations ne sont obtenues qu'à partir du seul combat. Pratiquer un travail lent dans des ateliers ou des usines ou déclarer des grèves. Sans ces luttes, les ouvriers n'obtiennent pas de leurs employeurs ni la liberté de fumer une cigarette sur le billot pour ceux qui n'ont pas pu se débarrasser de ce vice. Quelle est la réalité? Eh bien, l'employeur ne donne rien de son plein gré. Il faut donc se mettre en grève.
Et ceux-ci ont commencé à déclarer sans le gré des patrons ou des gouvernants, qu'ils préfèrent toujours protéger les patrons en mettant à leur service des moyens de protéger leurs intérêts, c'est-à-dire la police, la garde civile, qui sont mis à disposition. De ceux pour les grévistes à persécuter et les comités de grève arrêtés, même si ceux-ci sont déclarés avec préavis et légalement. Dans toutes les grèves qui ont été déclarées à ce moment-là, les améliorations demandées ont été obtenues, sûrement en raison de l'attitude militante des militants; ceux-ci étaient chaque jour plus nombreux, puisque les ouvriers se rendaient compte qu'avec ou sans la République, le système répressif augmentait chaque jour.
Le système de gouvernement a seulement changé de couleur, et le but était le même que dans ces temps de triste mémoire où tant de sang était versé par les travailleurs, parce que le système et l'intérêt des nouveaux républicains étaient de se positionner comme un parti politique, sans se soucier de nettoyer tout cela et ceux qui dans la monarchie et la dictature commandaient l'armée et la police et la garde civile. Et même dans l'administration, tous ceux qui avaient le commandement étaient maintenus à leur poste.Les généraux Mola, Sanjurjo, Cabanellas et le plus fatidique de tous, Franco, ont tous conservé leurs postes de commandement. Ce dernier au Maroc, où le soulèvement fasciste a commencé. Les trois premiers ont disparu dans des accidents mystérieux, peut-être parce que les futurs dictateurs ne pourraient pas être quatre - ou cinq, si l'on ajoute Queipo de Llano à l'intrigue. Un seul suffisait: Franco

le moins capable de tous, mais le plus audacieux, le plus dangereux et le plus sanglant de tous. Hitler n'est pas venu affronter les sujets allemands, bien qu'il ait été l'un des grands assassins, que l'histoire n'oubliera jamais. Franco a fait de l'Espagne un feu de joie, il a jeté les soldats, fils du peuple, contre ses frères, parce que le despote avait soif de sang. Et quand le combat fut terminé, victorieux de la guerre avec l'aide et la collaboration que Hitler et Mussolini lui ont donné pendant 36 mois, il avait encore des milliers d'Espagnols abattus, c'est-à-dire tous ceux qui sont tombés entre les griffes de la police et des phalangistes . Franco est mort pourri comme un ver infecté, comme si le sang espagnol qu'il avait répandu avait infecté les organes vitaux de ce corps d'hyène à la silhouette d'un homme. Mort atroce pleine de souffrance, s'il était capable de souffrir un tel monstre. Il est possible que dans sa longue agonie, il aurait préféré mourir devant un peloton d'exécution, car Godet et Burriel sont morts. Incalculable, monopolisé pendant ses QUARANTE années de dictature. PEUT-ON QUE LES JEUNES NÉS AU COURS DE CES QUARANTE ANS DE DICTATRICE PRENNENT NOTE DE CE QUE FRANCO ÉTAIT UN MONSTRE! Les hommes, militants du C.N.T. et la F.A.I., nous étions très préoccupés par le fait que ces gouvernements, avec les gouverneurs généraux et subordonnés, les chefs de police et de la garde civile, qui avaient agi et exercé des commandements à ce moment fatidique, continueraient dans leurs postes de commandement

C'est pour cette raison que le C.N.T. En plus de craindre que les travailleurs puissent subvenir à leurs besoins et améliorer leurs moyens d'existence et leur cadre de vie, puisque l'homme ne vit pas que de pain, l'inquiétude que nous, militants, avions, certains plus capables que d'autres, mais sans prétention supériorité, que dans la CNT il n'y avait pas de soi-disant chefs ou chefs et mandarins; chacun des affiliés au C.N.T. Nous avions les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est-à-dire que nous avions tous le plus grand intérêt à surmonter les difficultés pour la défense de tous. Ainsi, pour la défense de ce que le C.N.T. signifiait que le comité de défense confédéral était créé. Chaque syndicat avait ses groupes de défense, sa manière d'agir ou défensive. Ils n'ont obéi à aucun règlement; chacun d'eux a agi selon les circonstances imposées. Ce c'était la force de l'organisation confédérale. Il faut rendre à ces groupes la justice historique d'avoir vaincu l'armée dans les rues les 19, 20 et 21 juillet 1936.
Ces groupes sont responsables des succès obtenus dans toutes les grèves déclarées, de peu ou de grande importance. Dans les premiers mois qui suivirent la proclamation de la République, jusqu'en 1934, il y eut en Catalogne une fièvre de nationalisme et même de séparatisme, qui pour obtenir satisfaction dans l'ambition des politiciens bien établis du moment, Maciá. Companys et autres, et une lutte a commencé dans laquelle nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des travailleurs affiliés à la C.N.T. Une lutte que, parce qu'elle était de nature politique, l'Organisation confédérale, en raison de sa condition apolitique, ne pouvait pas accepter, et avec plus de raison, car à la fois un nommé Llui et Vallescá, et même des Companys, avaient un grand intérêt à notre disparition en tant qu'organisation parce que nous avions une grande influence au sein de la classe ouvrière et que nous l'avons retirée de l'environnement malsain de la politique.La fièvre séparatiste est apparue en 1934
CONTRADICTION AVEC LE PARAGRAPHE PRÉCÉDENT) et en tant que figures influentes les célèbres Dencas et Badía, la première avec le gouvernement civil et l'autre avec le quartier général de la police, soutenu par le statut catalan Els Rabasaires, Els Escamots et Compayns lui-même a commencé, comme à l'époque d'Arlegui et Martínez Anido, la répression contre la CNT et la FAI Pauvres dupes qui croyaient réaliser ce que monarchistes et dictateurs n'ont pas réalisé ensemble! Cependant, ils ont créé une situation très délicate pour nous au C.N.T., en utilisant les Escamot, qui, s'infiltrant à l'intérieur des usines et des ateliers, sont devenus de dangereux confident au service des Dencas et Badía. En raison de l'une de ces confidences, j'ai été arrêté en compagnie de José Montes, délégué du C.N.T. dans l'atelier où nous travaillions à l'époque.
Toute cette tentative de construire un statut catalan a mal commencé et s'est terminée pire, comme en témoignent la fuite des Dencás et Badía, la livraison et l'arrestation des Companys et l'abandon des armes par les Escamot dans les rues et les égouts de Barcelone. Certaines de ces armes ont été collectées, mais avec très peu de munitions, par les groupes confédéraux et la F.A.I. La situation en Espagne se compliquait de jour en jour. Les moyens d'existence devenaient de plus en plus chers et à juste titre les grèves se multipliaient pour obtenir des améliorations salariales, que les employeurs refusaient toujours d'accorder, donnant lieu à des conflits sociaux à perpétuer, car grèves qui ont duré des semaines et des mois
Et si la bourgeoisie avait les moyens de résister, les ouvriers de la C.N.T. nous travaillions dur pour attaquer les intérêts du capitalisme. C'est ce qui s'est passé lors des grandes et dures grèves des transports, des tramways et des bus; ceux-ci circulaient en petit nombre et protégés par un garde civil sur la plate-forme avant et un autre à l'arrière, ce qui n'empêchait pas que certains tramways soient incendiés chaque jour. Très sûr sans que les passagers ou les gardes ne subissent de dommages. Les gardes étaient auparavant non armés, c'est-à-dire dépourvus de pistolets et de verrous de leurs fusils sans qu'un accident ne se produise, puisque les gardes se sont laissés désarmer sans opposer de résistance. C'est ainsi que cette grève a été gagnée. Aussi le célèbre dans l'industrie du bois, qui a été déclaré plus tard et a duré 16 semaines. Dès la dixième semaine, et à la demande des employeurs qui employaient entre cinq et vingt travailleurs, venus du syndicat pour signer l'acceptation de toutes les bases qui avaient été présentées au début de la grève, ils furent autorisés à ouvrir les ateliers et à travailler le ouvriers. Les dix ou douze grands ateliers qui ont résisté pendant encore six semaines, résistance inutile car il restait peu de travailleurs en grève et ils recevaient une quantité de nourriture fournie par une Cooperativa Obrera de Pueblo Seco. D'autres grévistes avaient trouvé un emploi dans d'autres métiers. La grève avait été déclarée illégale, mais malgré cela, le C.N.T. C'était invincible, car la classe ouvrière espagnole a fourni un exemple à la classe ouvrière dans toute l'Europe.La grève avait été déclarée illégale, mais malgré cela, le C.N.T. C'était invincible, car la classe ouvrière espagnole a fourni un exemple à la classe ouvrière dans toute l'Europe.

SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION LOCALE DES SYNDICATS DE BARCELONE En 1935, j'ai été nommé secrétaire de la Fédération locale des syndicats de Barcelone. Le camarade Segundo Martín, membre très actif du syndicat des transports, a démissionné d'un poste aussi important. J'ai travaillé dans les ateliers Mateu-Marrugat de la rue de Naples et j'étais affilié au syndicat automobile. Ces ateliers étaient dirigés par le fils de Mateu, ainsi que par celui de Marrugat. Le gaspillage de ce «fils de père» dans les festivités et les femmes a provoqué la suspension des paiements de ladite société. Cinq ou six semaines s'étaient écoulées sans que nos salaires aient été payés, et pour cette raison nous étions le principal créancier de l'entreprise. Ainsi, lors d'une réunion-atelier, ils nous ont proposai socialiser l'atelier, qui a été accepté par tous les autres créanciers. Dans ces conditions, la proposition a été acceptée afin que nous puissions nous rendre au Conseil du travail de la Generalitat. Nous n'avions pas d'autre moyen. Le conseiller de l'époque, Peiró, a accepté de nous donner toutes les facilités. Et avec le crédit qui a été fourni, nous avons mis les comptes à jour.
Nous avions rejeté le concours du fils de Marrugat et au contraire accepté celui du fils de Mateu, qui collaborait loyalement avec nous. Dans le C.N.T. il n'y avait qu'un seul poste rémunéré, celui de secrétaire de la fédération locale. Il n'a été rémunéré que pour les heures perdues au travail, quand on lui a demandé d'intervenir dans la solution d'un conflit isolé, qui a soudainement éclaté dans un atelier. Il s'agissait d'un accord confédéral, qu'il fallait respecter, pour que les militants renoncent à des ambitions bureaucratiques ou à une direction sale pour obtenir un poste rémunéré qui leur permettrait de s'absenter du travail.
Dans le C.N.T., - à cette époque bien sûr - il n'était pas toléré ni permis que des candidatures soient présentées pour quelque poste que ce soit. Chaque syndicat a nommé un délégué à la fédération locale et ils ont nommé le secrétaire. Quand j'ai été nommé au poste de secrétaire de la fédération locale, nous étions dans la clandestinité, ce que je veux dire, avec les syndicats et les athenaeum fermés et notre presse suspendue. Et pour faire face à une telle imposition de silence, avec l'accord de tous les délégués, il a été décidé de publier un hebdomadaire clandestin dont le titre était
LA VOZ CONFEDERAL C'était ma responsabilité de trouver une imprimante pour imprimer l'hebdomadaire. Les choses n'étaient pas faciles à l'époque; Mais néanmoins, j'ai obtenu satisfaction dans mes efforts en la proposant au propriétaire d'une petite imprimerie récemment installée rue Vidalomat, acquise par une filiale de l'Union des Arts Graphiques, qui s'est émancipée de l'exploitation des patrons. Les conditions de montage de «La voz Confédéral» étaient que je devais l'aider et passer la nuit à l'imprimerie le jour de l'impression de l'hebdomadaire et que je devais lui apporter les originaux deux jours avant son impression. Celles-ci m'ont été remises par les délégués de la fédération locale au cours de la semaine. Pour tout ce qui concerne l'impression du journal, -le paiement des travaux..etc-. L'imprimeur n'a pas voulu connaître d'autre intervention que la mienne, une bonne condition pour le succès et la continuité de l'hebdomadaire.

Un caoutchouc important a été déclaré à l'époque par l'Union des services publics, la section de collecte des ordures, le nettoyage des égouts Arca ... etc. Cette grève qui a duré plusieurs semaines a mis en évidence l'importance de ces services avec les ordures entassées dans les rues et les places de la ville de Barcelone, ordures qui sont venues former d'immenses montagnes. Mais si la situation similaire a agacé les habitants de Barcelone, on leur a fait comprendre au moyen d'affiches collées sur les murs et aussi par «La Voz Confédéral», les justes demandes des travailleurs. Ils voulaient réaliser trois choses principales, se référant aux outils de travail, aux vêtements et au nettoyage, et à l'augmentation de deux pesetas par jour pour les salaires. Les bases ont été présentées à la société Miró i Trepat, concessionnaire des dits travaux par la mairie de Barcelone. Mais cela n'a pas été considéré comme affecté par les demandes des travailleurs, qui étaient payés par Miró i Trepat. Cette société, pour sa part, attendait une intervention de la mairie pour modifier le contrat et en augmenter le montant de quelques millions.
Pendant ce temps, ils ont continué à jeter les ordures dans les rues. Sans doute à la demande d'un député, la ministre de l'Intérieur de l'époque, Portela Valladares, est intervenue, envoyant le chef des services secrets, le capitaine Santiago, à Barcelone pour tenter d'établir certains contacts avec des représentants du C.N.T. Bien sûr, il lui a été difficile d'obtenir l'entrevue souhaitée, car le Comité régional, la Fédération locale et le syndicat de notre puissante organisation étaient fermés et les adresses de leurs représentants étaient inconnues.Je ne sais pas comment et pourquoi, le capitaine Santiago conduit a appris qu'un avocat, nommé Rusignol, pourrait peut-être entrer en contact avec le camarade Domenech, alors secrétaire du Comité régional. Il m'a informé qu'un entretien avec ledit délégué de la ministre Portela Valladares avait été proposé.
J'ai pris contact avec le comité de grève, qui nous a donné le pouvoir d'assister à l'entretien, mais à la condition, bien sûr, que nous ne signions aucun accord sans en informer au préalable le comité. L'entretien a eu lieu au quartier général de la police, et lorsque nous sommes entrés dans le bureau, le capitaine Santiago nous a dit de nous considérer comme des détenus si nous ne donnions pas l'ordre d'arrêter la grève et de ramasser immédiatement les ordures qui se trouvaient dans les rues et les places avant qu'elles ne commencent. les discussions. À une telle affirmation, j'ai répondu que dans le C.N.T. Les ordres autoritaires n'existent pas et Domenech a ajouté que notre détention aggraverait la grève et qu'elle l'étendrait même à une grève générale à Barcelone. Il a ajouté: Notre arrestation, vous devriez le savoir, provoquerait un mouvement de solidarité. D'autres personnes prendront soin de nos positions si nous allons d'ici à la prison de Modelo .En réalité, il aurait été difficile de mettre à exécution notre menace de grève générale.
Je dis difficile et il faut ajouter que c'était impossible dans les circonstances. La longue période de secret dans laquelle nous nous trouvions avait diminué notre force dans les affiliés. Les citations ne pouvaient pas être faites régulièrement. Nous avions de nombreux militants en prison, mais devant ce représentant de qualité du gouvernement, nous ne pouvions exprimer aucune faiblesse. En pensant ainsi à partir de ce moment-là, nous avions déjà un bon avantage dans la discussion qui a suivi et immédiatement, pour aller droit au but, si on peut le dire ainsi, j'ai dit au capitaine Santiago à propos du problème: «Je vous remercie d'avoir facilité ce contact, mais étant une ligne logique à la CNT l'action directe pour la résolution des conflits sociaux, la seule façon de les résoudre entre les deux parties concernées, c'est-à-dire les travailleurs et les employeurs, puis la solution du conflit qui existe entre Miró i Trepat et ses travailleurs, et le conseil municipal étant affecté, nous acceptons son intervention dans la discussion. Et même si nous considérons votre présence inappropriée, vous êtes autorisé à faciliter l'entretien avec Miró i Trepat et le conseil municipal.
En entamant les premiers mots avec le capitaine Santiago et en nous disant de nous considérer comme des détenus, il nous a accusés d'avoir déclaré illégalement la grève et de diffuser un journal clandestin, j'ai répondu que la grève avait été menée par le syndicat et non par nous, qui n'avons eu aucune intervention non plus. certains dans l'édition de "la voix confédérale", dont les syndicats pouvaient éditer des journaux et des magazines.Nous étions dans ce bureau depuis deux heures de l'après-midi. Santiago était arrivé de Madrid par avion militaire dans la matinée. À quatre heures de l'après-midi, la réunion a commencé dans une salle du conseil municipal avec deux représentants de Miró i Trepat, Martí Feced, conseiller pour le développement au conseil municipal et d'autres conseillers dont je ne me souviens pas des noms, Domenech et moi-même. Les représentants de Miró et Trepat ont voulu entamer la discussion des bases par la file d'attente, c'est-à-dire par les demandes sollicitées de moindre importance. Nous nous sommes opposés à cette formule et avons proposé de commencer par les plus importantes, considérant que chez les mineurs l'accord serait accepté plus facilement

Il en a été ainsi convenu. Nous y avons dîné avec des petits pains au jambon et des bières et avons continué la discussion jusqu'à deux heures du matin. Toutes les bases ont été pleinement acceptées: l'augmentation des salaires, l'installation d'armoires individuelles, de douches, de vêtements de travail par l'entreprise, chaussures comprises. Tout le nécessaire pour le nettoyage, car nous avons jugé inconcevable que des ouvriers affectés à des travaux aussi sales entrent chez eux en portant les mêmes vêtements de travail. Le conseil municipal a accepté de verser à Miró et Trepat le montant correspondant à l'augmentation des salaires. Une fois ce conflit terminé avec un succès total, le plus dur à réaliser de la part du ministre de l'Intérieur reste: ouvrir les syndicats. Et avec les bases signées, nous sommes allés au quartier général de la police pour une réunion préalablement demandée par téléphone. Nous avons demandé à Santiago l'ordre de supprimer les scellés judiciaires que les différents tribunaux avaient placés sur les portes d'entrée des syndicats.
Santiago a accepté d'ouvrir le syndicat des services publics, bien qu'il n'ait pas promis d'ordonner l'ouverture des autres, faisant de l'insurmontable «principe d'autorité» un obstacle. Il serait comme trois heures du matin quand, après l'avoir demandé par téléphone à Madrid, il a accepté d'ouvrir un autre syndicat de son choix. Je lui ai proposé le syndicat du bois. «Non, non et non, proposez-en un autre. Le mercantile, par exemple, et ensuite je vous ouvrirai le reste. Cela soutient le principe d'autorité. " Vers trois heures du matin Les scellés ont été retirés de la porte d'entrée des syndicats de la fonction publique pour admettre les grévistes qui attendaient dans la rue. On m'a confié la tâche agréable de lire les bases signées, ajoutant que le paiement de 50% des jours perdus avait également été obtenu, tout en augmentant en même temps qu'à cinq heures du matin le travail devait commencer. Des voix ont été entendues disant: "Nous allons commencer à travailler demain." La réponse fut rapide: «en raison du sérieux du C.N.T. et par le mot de la Fédération locale, il n'y a pas de lendemain ou d'après-demain qui vaille: tous les ex-grévistes à leurs postes à l'heure habituelle ». Et c'est arrivé la fin de la grève, ainsi que l'ouverture des syndicats, ont circulé comme une traînée de poudre dans tous les quartiers et quartiers de Barcelone.
Les sceaux de fermeture de tous les syndicats ont été enlevés et ceux-ci ont été occupés par de très nombreux membres du même. Connus la manœuvre par la police, ils ont été refermés. Encore une fois, les timbres ont été arrachés et les locaux occupés
La police n'est plus intervenue et a ainsi mis fin à cette longue période de clandestinité. Et comme la presse «SOLI» continuait à être fermée et que «La voix confédérale» continuait à la remplacer avec succès, la police n'a pas découvert l'imprimerie qui l'avait publiée. Mais l'adage dit qu'il n'y a pas de secret entre trois. Entre l'imprimeur et le chauffeur de taxi qui a fait la livraison avec moi, il ne pouvait pas y avoir de chitos. Nous aurions été découvert tout de suite. Depuis 1931, lorsque cette République nous est venue avec tant de douceur, la CNT, je veux dire, ses militants, nous avons été constamment persécutés et nous avons vécu des heures très amères.
Nos maisons ont agressé, touchant et souffrant nos familles des conséquences dures et amères de toutes ces injustices. Les dirigeants, à commencer par le président de la République, qui a ordonné la répression des événements de Casas Viejas, celle des «coups de feu au ventre», n'ont pas su démanteler toutes ces forces de réaction qui sapaient le pouvoir avec la collaboration de cette bande de généraux qui, en 1936, ont implanté la dictature de fer qui a semé la terreur pendant quarante ans en Espagne

https://sniadecki.wordpress.com/2017/10/24/cnt-saragosse/
Ayant dit ce qui précède entre parenthèses, je continue de tisser le tissu de mes souvenirs pour dire que la fin inattendue de ces mois de secret dont je viens de parler, était quelque chose comme un répit qui a permis au C.N.T. la préparation du Congrès qui s'est tenu à Saragosse le 1er mai 1936. Du Secrétariat de la Fédération Locale, que j'ai occupé avec un tel succès, bien sûr le succès collectif de nous tous qui l'avons formé et l'enthousiasme en collaboration de nous tous qui l'avons composé, nous avons mis tout l'enthousiasme pour que la participation des syndicats à Barcelone soit effective . Et ils sont effectivement intervenus dans les discussions sur une élection aussi importante. Mai 1936, avec le Congrès confédéral, représente une étape importante sur le chemin parcouru par le C.N.T. Telle fut l'histoire des années suivantes, ainsi que des nouvelles générations. Mais les forces réactionnaires, dirigées par Cambó, ce qui revient à dire que ceux qui ont imposé la dictature de Primo de Rivera, n'ont jamais pu digérer l'établissement de la République. Ils n'ont cessé d'intriguer, de préparer des complots dans l'ombre contre la liberté, et surtout contre le C.N.T. À chaque réunion de la fédération locale, il y avait toujours un ou deux délégués à elle, qui prouvaient que quelque chose de dangereux se préparait contre les travailleurs que nous représentions.
Toutes les propositions des syndicats ont été exposées dans le même sens: il fallait se procurer des armes et autres éléments nécessaires pour contrer toute tentative de coup d'État. Nous étions sortis de notre cachette.
La fédération locale recevait normalement sa part du sceau confédéral; Mais cela ne suffisait pas pour acquérir une grande quantité d'armes, car il fallait obtenir de l'argent en quantité, à la fois des groupes de défense et des syndicats. Bref, il fallait s'organiser en ce sens; C'est comme ça que ça s'est passé. En tant que secrétaire du Fédération locale, j'ai reçu toute la confiance des délégués à la même, afin que notre potentiel en ce sens soit augmenté. Nous avions, bien sûr, des armes bien stockées et conditionnées dans une cachette, située dans un verger sur le Paseo de la Cloaca. Ce jardin me servait de récréation les samedis et dimanches. Là, je me suis reposé avec ma famille toutes les vacances et personne ne savait, à part le délégué à la défense de la fédération locale, que nous avions la cachette dans ce verger.
J'ai connu Ramón Moneo, un homme très sérieux et réservé, alors âgé de 60 ans. Ce collègue avait arrêté son travail d'huissier pour cause de maladie au palais de justice, où se trouvait également un de mes oncle qui occupait le même poste d'huissier. Par lui, il a connu Moneo. Ce dernier, depuis qu'il a cessé d'exercer ledit emploi, se consacrait à la vente d'objets divers, tels que stylos plume, montres, appareils photo ... etc. Selon lui, ces objets provenaient de prêteurs sur gages, mais je n'ai jamais été intéressé à savoir d'où venaient ces objets, même si je lui ai acheté un appareil photo une fois. Cependant, notre amitié s'est resserrée, en parlant de dictatures, de l'avènement de la République et d'autres événements de cette époque. Au cours de ces conversations, il m'a dit qu'il avait rencontré les capitaines Galán et García Hernández, abattus à Jaca. Il a également avoué? être un ami de Díaz Sandino, de Ponce de León? et aussi du capitaine Meana, qui était alors secrétaire du gouverneur ou délégué de l'ordre public du gouvernement de Barcelone, M. Spain.Je ne pensais pas à ce moment-là que les amitiés de Moneo avec ces militaires pouvaient être utiles à la CNT, et que moi, en tant que secrétaire de la Fédération locale, je pourrais un jour intervenir très prochainement comme lien entre eux et l'Organisation confédérale, pour confronter les coup d'État militaire qui a eu lieu initialement au Maroc. Moneo avait son poste d'action dans un bar qui était dans la rue de Conde de Asalto appelé «Los Pajaritos»

Là je suis allé le voir et j'ai vite compris que grâce aux relations que j'avais et aux personnes que je fréquentais, il pouvait faciliter l'acquisition de quelques armes légères. Saisi par ce souci, j'ai expliqué mon intérêt à les acheter. Il a prêté attention à mes propos, et le lendemain, il m'a présenté à un employé des tramways, un homme de confiance, qui comme lui, se consacrait à la vente d'objets divers. Entre Moneo et l'employé du tram, j'ai pu acquérir quelques pistolets de gros calibre, tous avec le numéro de série effacés. Peu de chose que l'achat était, mais ne pouvant pas trouver d'autres sources, nous n'avons pas fermé ce robinet. Dans un arsenal d'Hostrafanch, j'ai pu obtenir un pistolet d'occasion en bon état, et surtout, avec des munitions. L'armurier en question était un excellent collaborateur dans l'achat d'armes à l'étranger, dans les années tragiques de 1936-1937.
(RÉÉLECTION EN TANT QUE SECRÉTAIRE) Au bout d'un an, j'ai été de nouveau confirmé au poste de secrétaire de la fédération locale. J'ai accepté de continuer avec l'enthousiasme à servir la cause libertaire. En réalité, le poste de secrétaire produit une énorme quantité de travail, qui s'ajoute à celle d'une journée de travail, augmente la fatigue et la fatigue, car pour traiter la correspondance qu'il recevait quotidiennement à la section locale, et que parfois il devait répondre de toute urgence. Il y avait de nombreux jours où, à deux heures du matin, je travaillais encore à la machine à écrire, un travail auquel je n'étais certainement pas très pratique pour jouer du piano à bande. Quoi qu'il en soit, je me suis engagé à continuer en tant que secrétaire et il ne s'agissait pas de reculer, surtout dans ces moments que nous vivions, et dans lesquels nous voyions arriver des situations dangereuses pour la CNT, une organisation 100% apolitique et défenseur des travailleurs, qui n'a jamais servi comme tremplin pour les futurs conseillers et députés, dont le seul intérêt était de prendre position, de gravir les échelons du parti politique auquel ils étaient inscrits, et ainsi d'augmenter leurs comptes chèques à la banque.
Et nous, les ouvriers, n'aspirons à rien d'autre qu'à l'effort de notre travail, pour pouvoir souder la fin du mois avec lequel elle suit.Nous approchions à grands pas de la date fixée pour la célébration du Congrès de Saragosse. En attendant, nous ne pouvions pas perdre de vue les activités de la réaction, ses allées et venues dans les différentes régions d'Espagne; ses contacts avec des personnalités monarchiques et militaires, et ils ne se cachaient plus pour agir, puisque ni le gouvernement de la République ni la police ne réagissaient contre cette manœuvre éhontée des serviteurs de cette dictature de si triste mémoire

Le Congrès a déjà eu lieu, et bien qu'il ait remplacé Horacio Prieto au Secrétariat national, poste qu'il occupait avec mérite et succès, et qu'en vérité il n'a pas accepté car il a été réélu avec juste raison en raison des attaques qui lui ont été dirigées par certaines délégations. du Congrès, attaques avec lesquelles il a été, comme on dirait, poignardé comme si la rapière était un torero accrédité. Le C.N.T. Il a quitté le Congrès de Saragosse avec plus de force et d'autorité syndicales que jamais, et avec un avenir très prometteur et crédité pour l'organisation libertaire, en particulier en Europe. Le C.N.T. Il avait construit un mur que la bourgeoisie espagnole ne pouvait pas abattre, et il n'a pas non plus fait revivre cette époque où les militaires les plus éminents ont été abattus tout au long Espagne. Il avait besoin de la collaboration active de l'armée, et pensant qu'elle ne pouvait être vaincue, il entama la danse des généraux, ceux qui, dans une mauvaise heure, les gouvernements républicains qui se succédèrent leur permit de continuer dans leur commandement. Et au Maroc, Franco, le plus incapable - c'est ainsi que les militaires fidèles au gouvernement le considéraient - était plus audacieux que les Sanjurjo, Cabanellas, Mola, Queipo de Llano et même Goded.
En juin 1936, la température fasciste montait à plusieurs degrés au-dessus de zéro, et au début de juillet, elle augmentait de telle sorte qu'à commencer par le président de la République, Azaña, celui avec les coups au ventre, et se terminant par tous ceux qui les frappaient. ils étaient fidèles, ils ont commencé à trembler et à craindre pour leur vie comme celui qui s'accroche à un fer chaud. Quelle position appeler dans des circonstances aussi tragiques? Il n'était pas possible de s'agenouiller devant un ennemi qui avait fait la sourde oreille à toutes les lamentations; Il n'y avait qu'un seul moyen: demander de l'aide à ceux qui ont dû périr comme eux sur le même bûcher, c'est-à-dire aux défenseurs les plus actifs de la liberté, auxquels nous avions fait des preuves à maintes reprises, pour se rebeller contre toutes les injustices
Faire appel à la C.N.T., ainsi qu'à l'U.G.T., armer ses militants; Mais quand il s'agissait de donner des armes aux libertaires, cela représentait un danger pour eux, car après avoir vaincu les rebelles, nous utiliserions les armes contre les représentants du régime capitaliste dépassé que représentait la République bourgeoise. Grosse erreur! Même si cela avait été comme ça, nous n'aurions jamais attaqué ceux qui manifestaient pour représenter démocratiquement le peuple, étant sûrs que les gens en armes avaient arrêté le soulèvement fasciste et qu'une fois les fascistes dans la rue, seulement un miracle, on pensait et craignait, Il pourrait vaincre une armée propriétaire de la rue et en possession de sites stratégiques et de dépendances principales. Cependant, d'en haut, des mesures ont été prises pour empêcher une telle tentative de fascination sérieuse d'avoir lieu, faisant intervenir les bons offices de l'ordre de la maçonnerie, car il y avait des francs-maçons des deux côtés, sans grand espoir d'éviter la catastrophe nationale. .

Dans les derniers jours de juin, je ne peux pas préciser via la chaîne ou de quelle personne, un entretien avec le capitaine Meana nous a été proposé. En principe, nous pensions qu'une telle proposition venait de Ramón Moneo. Nous avons pris contact avec lui en particulier moi et il m'a dit qu'il n'avait pas participé à ces efforts. Nous avons eu un premier contact avec Meana dans le café appelé "Les sept portes".
Juan García Oliver Buenaventura Durruti Francisco Ascaso
Les entretiens se sont poursuivis au Leather Union. Meana a assisté à ces réunions, conduite par son chauffeur privé, un caporal de la Garde civile, très gentil en effet. Pour notre part, García Oliver, Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso et moi avons participé aux réunions. Pendant le mois de juillet, nous nous sommes vus tous les jours. On savait qu'à l'intérieur de la caserne il y avait des réunions de patrons et Meana, par confidences, Il était bien conscient que les Phalanges devaient participer au soulèvement, facilitant les falangistes, qui, entrant dans la caserne à l'heure X, porteraient l'uniforme militaire pour, par leur action, encourager les soldats. Cela a été déclaré catégoriquement par Meana. Dans les réunions, nous avons essayé dans un sens interrogatif, s'il ne serait pas plus efficace d'exercer une vigilance sérieuse pour empêcher les falangistes d'entrer dans la caserne, en les éliminant s'ils étaient trouvés en possession de la carte Phalange, ou pour attaquer les troupes dès leur départ. dans la rue.
Ce dernier fut adopté: les groupes de défense confédéraux devaient être situés à proximité de la caserne pour une surveillance commode. Au Comité de la Défense, nous avions confiance dans les militants qui faisaient partie des groupes. Nous avons été informés des différents quartiers à cet égard. Dans ces conditions, nous entrons dans la vie des rencontres; Cela signifie que chaque groupe possédait des armes et des munitions, mais pas assez pour soutenir le combat s'il se poursuivait. Au contraire, si la résistance était vaincue dans une ou deux casernes, nous avions un avantage de 50%, mais si le combat continuait, tout était perdu de notre côté.
Meana a déclaré que dans le gouvernement civil, il y avait beaucoup d'armes légères et de nombreuses munitions. Et à propos de la livraison desdites armes à la C.N.T, il s'était entretenu avec M. España, son supérieur immédiat, et il avait accepté de nous armer, mais sans précipiter, car des mesures étaient prises pour empêcher le soulèvement des militaires. Nous avons supposé que la maçonnerie était celle qui a effectué ces étapes. Pour notre part, nous pensions que l'opinion de M. Espagne était très puérile, convaincus que nous étions que le soulèvement militaire se produirait inévitablement. Meana nous a dit qu'elle était d'accord avec nous, ainsi que Díaz Sandino, Ponce de León et surtout «Guarner».
Nous ne savions rien de la stratégie militaire. Nous ne comptions que sur le courage et l'enthousiasme des escouades de défense confédérées dont disposait l'organisation. Le combat que nous allions mener était donc très inégal, notamment pour vaincre l'armée qui avait toujours été victorieuse en 1909, 1917 et 1934, ... etc.
A ces occasions, l'armée a obéi et exécuté les ordres du gouvernement. Cette fois, les circonstances étaient très différentes, puisque ce dernier faisait confiance au peuple pour vaincre l'armée, et un phénomène pouvait se produire, que les vieux soldats, en particulier les chefs, avaient peur de voir tout le peuple en armes. . Dans ce contexte d'agitation les jours suivirent et l'heure X approchait. Les groupes de défense ont été mobilisés et pourtant, au crépuscule, personne n'a montré de fatigue. Nous étions déjà le 15 juillet. On savait ce qui se passait au Maroc, et précisément ce jour-là nous avons tenu une réunion à la maison de la décharge du Prat de Llobregat, qui avait une grande influence sur le secteur de gauche de la ville. Je regrette de ne pas me souvenir de son nom, car lors de cette réunion, nous nous sommes retrouvés avec un repas que le propriétaire de la maison nous a offert en cadeau: du lard de porcelet que je cuisine à la dernière minute. Meana, Ponce de León, Díaz Sandino, Ramón Franco -l'aviateur-, Durruti, García Oliver, Francisco Ascaso et moi-même étions présents. Ramón Franco, parlant de son frère, a déclaré: "Cela semble un mensonge, impossible, qu'un fils de pute vienne d'une très bonne mère." Les mots sortent de sa bouche. Il a payé cher sa trahison, car il est mort lâche. Quelques jours après cette réunion de Prat de Llobregat, l'heure X que nous attendions depuis des jours sonnait: le 19 juillet 1936
Lorsque Séguí a été assassiné le 10 mai 1923 à l'intersection des rues Cadena et San Rafael, il était accompagné de François Coma connu sous le nom de «Peronas». Ce dernier, grièvement blessé, a été récupéré par des voisins et emmené à l'hôpital de Santa Cruz, mais est décédé quelques jours plus tard. DANS LE COMITÉ MILITAIRE Ce 18 juillet, il avait, comme la plupart de ses compagnons, dormi comme des lièvres pendant deux nuits, les yeux ouverts. Toutes les armes dont dispose la fédération locale ont été distribuées. Malheureusement, la fédération locale ne dispose d'aucun arsenal. Très tard maintenant, García Oliver, Durruti, Aurelio Fernández et moi, de la rue Mercaders, nous nous sommes mis sur la route du gouvernement civil. Le capitaine Meana nous avait dit qu'il y avait là de nombreuses armes, pour la plupart courtes mais de gros calibre. Aussi beaucoup de munitions. M. Spain était celui qui pouvait en disposer. C'est donc à son supérieur qu'il fallait les solliciter. Meana nous avait déjà dit que c'était à cet homme que nous devions les solliciter, puisqu'il est délégué du gouvernement à l'ordre public en Catalogne.
À la porte centrale du gouvernement civil, il y avait deux gardes de sécurité. Sans être surpris de nous voir armés, ils nous ont demandé ce que nous voulions. À ce moment-là, le caporal que nous connaissions déjà est apparu, étant le chauffeur de Meana. Il nous a rejoints et nous a accompagnés au bureau du Señor España, où se trouvaient une dizaine de personnes, dont le colonel Escobar, de la Garde civile.Notre entretien a été très court, car cet homme a montré qu'il n'était pas déterminé à nous fournir des armes, affirmant que pour le moment, il n'y avait aucune crainte que les militaires quittent la caserne, et qu'il ne savait pas l'usage qui pourrait être fait des armes. armes entre les mains de la CNT-FAI Ces paroles nous ont tellement scandalisés que Durruti a dit à tous ceux qui étaient rassemblés là-bas, quittant déjà le bureau, que nous nous battrions avec les armes que nous possédions, et qu'ils gardaient à l'esprit que si l'occasion se présentait, avant d'être vaincus, nous y irions et ce seraient nos dernières victimes.
Nous claquons les portes. Dans ce long couloir, Meana est apparue. Quand elle lui a dit qu'on nous avait refusé des armes, elle s'est rendue au bureau de M. España et lui a dit: "Les armes qui ne vous seront pas données, je vous les donnerai sous toute ma responsabilité." Il nous a dit d'attendre. Il avait un porte-clés à la main. "Suivez-moi, allons sur le toit." Il y avait plusieurs pièces, à savoir la clé qui correspond à chaque pièce. Nous étions tellement nerveux que Durruti a commencé à casser les portes avec un coup de poing net. À la fin, nous avons chacun épaulé une boîte et avons commencé à faire des voyages vers le patio, déposant les boîtes dans deux voitures que Meana a indiqué. Nous avons fait quatre voyages de là à la Calle de Mercaders. Il y avait là de nombreux camarades prêts à se battre, dont nous avions apporté les armes du gouvernement civil. Si nous avions eu ces armes 24 heures plus tôt, nous aurions eu moins de victimes.
Parmi ces centaines de combattants du C.N.T.-F.A.I.Un bon nombre de combattants de la liberté nous ont rejoints, assez inconnus des partis et de la CNT, comme un nommé Pedro, un cordonnier plausible que j'ai rencontré devant le couvent de Pompéi. C'était un bon artilleur. Il était là avec son partenaire, puis elle était dans les patrouilles de contrôle avec mon partenaire jusqu'à leur dissolution. Le départ des troupes de la caserne d'artillerie n'a pu être empêché, car il a été empêché de quitter la caserne de l'Avenida de Icaria, qui a été empêchée d'approcher le gouvernement civil. Les troupes descendant le parallèle ont également été empêchées de se connecter avec celles de la caserne d'Atarazanas. Ce sont ceux qui ont le plus résisté, ainsi que ceux du gouvernement militaire. Là, nous avons perdu l'un des militants les plus actifs de la C.N.T., Francisco Ascaso.
La résistance dans la place a continué. Meana a décidé d'envoyer un message à Díaz Sandino, Avec le caporal de la Garde civile, chauffeur de Meana, nous sommes allés à l'aérodrome de Prat de Llobregat. Le caporal sans tricorne, lui avait sûrement donné des coups de pied aux premières heures du matin en présence d'une vingtaine de gardes civils qui se tenaient par terre devant le bar de la plage devant le gouvernement civil. Nous y étions allés prendre un café. Les gardes là-bas, tous des vétérans, ont été témoins de la façon dont il a marché sur le tricorne et l'ont entendu dire "Je voulais faire sortir cette chose de ma tête!" Aucun des gardiens présents n'a fait de mouvement de désapprobation du geste du caporal. Le message adressé à Sandino lui disait de survoler la caserne d'Atarazanas, les avertissant que s'ils ne se rendaient pas, ils seraient immédiatement bombardés.
Les tirs ont continué pendant une courte période, puis un drapeau blanc a été hissé. Quand nous sommes revenus d'El Prat, nous l'avons fait par Hospitalet et La Torrasa, en descendant la route Sants Hostafrancs, rue Ciento, en remontant vers la rue Roussillon
Nous suivons cette rue jusqu'au Paseo de Gracia. Dans la rue Roussillon, ils nous ont tiré dessus à plusieurs reprises. Juste avant d'arriver au trajet, heureusement abattu très bas, nous avons fait sauter un pneu devant la voiture. Nous avons descendu le Paseo de Gracia sans nous soucier de changer de pneu, en direction du gouvernement civil. À la hauteur de la calle de Valencia, nous avons vu le lieutenant-colonel Escobar avec deux compagnies de la garde civile monter vers la Diagonal en criant «Vive la République! En arrivant au gouvernement civil, Capital Meana nous a dit qu'Altarazanas avait été remis, ainsi que le général Goded, au président Companys. Les 18 et 19 juillet, il est impossible de calculer le nombre de victimes que nous avons eues dans le C.N.T et le F.A.I.
Bien sûr, ils étaient nombreux, car la lutte contre les militaires les rebelles étaient durs, très durs. Seul chaque syndicat pouvait donner un chiffre approximatif de ceux qui sont tombés au cours de ces 36 heures de lutte pour la liberté. A tous ceux qui sont tombés, les mêmes honos, le même souvenir. Pour nous, ceux d'entre nous qui avaient des heures difficiles à traverser, un temps indéfini nous attendait. Nadir pouvait calculer qu'il nous restait encore 36 mois pour prouver au monde du travail, à ses compagnons de travail, que le prolétariat espagnol combattait avec ténacité la bourgeoisie réactionnaire.

Tous les militants du C.N.T.-F.A.I. de Barcelone et de ceux qui sont arrivés de différentes régions catalanes, dans cette modeste salle de réunion de l'union de la construction de l'ancienne rue Mercaderes, il n'y avait qu'une seule préoccupation parmi tous ceux qui y étaient rassemblés: continuer la lutte pour libérer les autres régions d'Espagne entre les mains de l'armée de factions.
Un coup de téléphone de la Generalitat de Catalogne, de la part de son président Companys, a demandé qu'une commission de la Confédération nationale du travail se rende d'urgence à la Generalitat. La commission a été nommée. Il a été formé par García Oliver, Durruti, Aurelio Fernández et moi-même. À la Generalitat, nous avons été présentés au bureau de Companys. Il y avait aussi le président, Artemio Aiguader et la mystique Ventura Gasol, cette dernière au visage aigre. Les premiers mots du Président ont été les suivants: «Je dois d'abord saluer les héros du jour» Et il a poursuivi: «Je ne représente plus rien. Au C.N.T. la Présidence de la Generalitat appartient ». Avec étonnement, nous entendons ces mots sortir de la bouche de Companys. Nous lui avons répondu "votre devoir est de garder la Présidence qui vous est confiée par le peuple de Catalogne". Il a insisté pour qu'on lui donne un siècle qui porterait son nom et qu'avec lui il combattrait sur le front de l'Aragon, aux confins de la Catalogne.
Nous lui avons fait comprendre que la lutte contre le fascisme ne pouvait se limiter à une seule région, qu'il fallait combattre là où se trouvait l'ennemi et que c'était sur tout le territoire national. Finalement, il a compris que son devoir était de garder la Présidence avec toute la responsabilité du moment. Jusqu'à ce moment, il ne nous a pas dit que dans une pièce voisine, il avait rassemblé des représentants de divers partis politiques et organisations qu'il avait convoqués, afin de former un comité de la milice, mais que rien ne pouvait être fait sans notre présence et notre accord. Nous lui avons répondu après une consultation préalable entre nous, qu'en principe nous nous sommes entendus sur la création d'un comité de la milice. Cependant, nous avons dû consulter le cas de l'organisation confédérale.
Nous avons accepté la formation du Comité à condition qu'il ait l'entière responsabilité de mener la lutte. En ce sens, il est paru dans le Bulletin de la Generalitat le 20
Juillet, formation du comité de la milice. Le service Sécurité et Surveillance a été confié au C.N.T.-F.A.I. Le responsable était Aurelio Fernández, auquel s'ajoutaient Tomás Fábregas et moi-même. Nous avons décidé de former de toute urgence des Partullas. Son but était d'exercer une surveillance et en même temps de contrôler les activités de diverses personnes suspectes, car il était évident que tous les individus appartenant à la Phalange, ainsi que les militaires qui faisaient partie de la conspiration fasciste et qui avaient survécu à ces 36 heures de combat dans les rues de Barcelone, ils formeraient une cinquième colonne et en se cachant ils informeraient les quartiers franquistes de ce qui se passait dans le nôtre.
Les patrouilles de contrôle devaient être formées par des hommes de toute confiance, à qui confier cette responsabilité, et pour cette raison nous avons approché tous les syndicats ainsi que tous les partis et organisations qui formaient le comité de la milice, pour nommer un plusieurs de ses militants pour faire partie des patrouilles qui devaient être constituées.
J'ai été nommé premier responsable desdites patrouilles de contrôle et j'ai accepté cette nomination, car les circonstances l'exigeaient. J'aurais préféré un autre poste. Au sein du comité, j'ai fait tout ce qui pouvait être fait humainement, bien soutenu par Tomás Fábregas, pour que l'action des hommes qui formaient les patrouilles de contrôle ne ressemble pas du tout à celle de la police et de la garde civile, c'est-à-dire des coups. et la torture contre les prisonniers.
Aucun règlement n'existait dans les patrouilles. Le responsable de chaque section doit veiller à ce que les détenus soient respectés en tant qu'hommes et qu'à aucun moment ils ne soient contraints ou maltraités à faire de fausses déclarations ou à dénoncer des innocents.
Bien que les patrouilles comprenaient des militants des patidos et d'autres organisations qui composaient le Comité de la milice, le C.N.T. il avait une grande majorité dans les patrouilles. Nous avons toujours combattu les sévices et les tortures pratiqués par la police au service de l'Etat. Ce n'était donc pas une question que nous ayons oublié un seul instant les Droits de l'Homme, puisque nous, libertaires, étions les plus indiqués pour les faire re
Un problème se posait à nous pour trouver un endroit pouvant servir de prison, mais comme il devrait y avoir des geôliers dans une prison et qu'il serait difficile, voire impossible, de les trouver dans nos médias, nous n'avons pas voulu donner le nom de prison à un locaux destinés à accueillir les futurs détenus, tant qu'ils n'ont pas été condamnés. Nous, les patrouilles de contrôle, n'avons pas été autorisés à condamner un détenu.
En acceptant, au sein du Comité de la milice, de laisser les religieuses qui souhaitaient se rendre en Italie, une demande sollicitée par le Vatican via la Croix-Rouge internationale, le couvent de San Elíasnos est devenu le lieu où nous voulions abriter le futurs détenus.
Un navire est venu d'Italie pour embarquer toutes les religieuses qui voulaient fuir la zone rouge, qui était le nom fatidique avec lequel Franco appelait l'Espagne libre. Pour le despote du factieux, c'est nous qui nous opposions à être retenu sous sa botte sanglante. J'ai pris soin de contrôler l'ascension vers le bateau des religieuses qui partaient. Ils ont bien appris la réponse qu'ils avaient à dire: "Si nous restons ici, ils nous tueront", à laquelle j'ai répondu: "Si tel était notre but, le navire qui vous emmène en Italie ne serait pas ancré dans le port, alors c'est que s'il veut rester, sa vie sera respectée et un travail lui sera donné. "

Certains sont restés, devant un regard de mépris dirigé par le supérieur du couvent, qui était assis tout près de moi, écoutant les questions que je leur posais, avant d'écrire le nom sur une check-list que nous avions préparé pour certifier le numéro et nom des religieuses qui partaient. Sur une autre liste figurait le nom de ceux qui avaient décidé de rester.
Toutes les religieuses qui sont parties étaient préalablement enregistrées dans des kiosques aménagés à cet effet et par des femmes. Beaucoup d'entre eux ont trouvé des pièces d'or qui, selon eux, appartenaient à la communauté. Ces pièces ont été confisquées.
Le couvent de Sant Elias a servi de lieu de détention pour les suspects et pour la première fois dans l'histoire des révolutions, des soulèvements ou des coups d'État, les détenus ont été traités avec le maximum de respect humain, jusqu'à ce qu'ils soient remis à la justice ou libérés. . Tous les détenus mangeaient dans une salle à manger commune et étaient servis à table, avec beaucoup de nourriture et le droit à un verre de vin à chaque repas. Les légumes servis provenaient du grand jardin qui se trouvait dans le couvent. Le jardinier chargé de cultiver les légumes était le même qu'à l'époque où le couvent existait. C'était un homme d'une soixantaine d'années, travailleur et heureux d'avoir été maintenu à son poste. Il s'occupait également d'élever des porcs, élevés avec les restes de nourriture et de légumes du jardin.
La surveillance des détenus était très limitée. Cependant, lorsque vous entrez, vous êtes averti que toute tentative de fuite mettrait votre vie en danger. Cet avertissement a été bien entendu, car il n'y a pas eu une seule tentative d'évasion. À aucun moment, aucun détenu n'a été maltraité. Tous les hommes qui faisaient partie des patrouilles de contrôle avaient été emprisonnés et aussi passages à tabac entre les mains de la police d'État et de la police de la Generalitat de Catalunya avant le 19 juillet, et pour cette raison, ils ont détenu de telles procédures, de sorte qu'ils ne les ont jamais utilisées avec les détenus.
Malgré le fait que nous ayons tout mis en œuvre pour être reconnu pour une activité très impartiale dans la découverte d'individus appelés falangistes et autres militaires, par exemple qui avaient participé au soulèvement fasciste, il y avait un général, très enthousiasmé par les auditions quotidiennes. sur Radio Sevilla, qui nous a traités de meurtriers vulgaires. Selon lui, dans le couvent de San Elías le lard était élevé avec de la viande humaine, en particulier des prisonniers qui y entraient très gras. Ceux qui n'avaient que de la peau et des os, il a dit que nous les avons jetés dans un puits.

Dans la vie, Queipo de Llano, qui s'appelait le général charlatan, espérait faire un portefeuille avec ma peau.
Ce général, le 19 juillet, a envoyé les troupes dans les rues en criant «Vive la République!» Afin de rencontrer les militaires fidèles au gouvernement et aussi les compatriotes qui l'ont défendu. Le nombre de soldats et de compatriotes qu'il avait abattus est incalculable. La même procédure a été utilisée dans d'autres régions dominées par les fascistes.
Dans tous les coups d'État ou mouvements révolutionnaires, surtout dans les premiers jours après leur déclaration, des actes de violence ou de vengeance personnelle très regrettables ont eu lieu. Certains d'entre eux sont bien justifiés pour les personnes qui ont mené le soulèvement fasciste de 1936. Cela ne pouvait pas être une exception dans ces vengeances personnelles.
Dans les patrouilles de contrôle, toutes les précautions ont été prises pour mettre fin à ces actes de violence incontrôlés, bien qu'il soit impossible de contrôler tous ceux qui les ont commis, car beaucoup avaient des armes à l'époque.
À ma demande et avec l'accord du Comité de la milice, un Bando a été publié - je suis désolé de ne pouvoir trouver un tel groupe dans aucune archive de Barcelone pour en écrire le texte exact dans ces mémoires - qui a été publié dans tous les journaux et également fixé sur divers murs des rues et des places de la ville. Nous, C.N.T.-F.A.I., qui étions la majorité en tant que délégation au Comité des Milices et Libertaires, étions les plus intéressés à démontrer à toute l'Espagne que pour nous défendre, nous n'avions pas ou ne voulions pas utiliser des procédures sauvages et criminelles telles que celles utilisées par les franquistes. On savait déjà que dans la zone occupée par eux, ils ont tiré sur des soldats fidèles à l'armée républicaine et il en a été de même avec des ouvriers appartenant aux deux centrales syndicales C.N.T et U.G.T, tombés entre leurs mains.
Le Bando publié a déclaré, en résumé, que toutes les personnes qui avaient une plainte à présenter avec des raisons justifiées, en particulier dans ce qui se référait à une arrestation ou à la disparition d'un parent, devraient se présenter au Comité de la milice ou aux patrouilles de contrôle, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, certains qu'une telle plainte serait traitée. Publié le Bando, il y avait beaucoup de gens qui se sont manifestés pour réclamer un parent disparu.
Pour ma part, comme pour les hommes qui composaient les patrouilles, tout ce qui était en notre pouvoir a été fait pour satisfaire les demandeurs et des sanctions ont été appliquées à ceux qui abusaient de leur pouvoir pour commettre un acte sans scrupules. J'ai été contraint de renvoyer un comité révolutionnaire d'une ville proche de Barcelone, pour avoir utilisé une procédure barbare pour extraire une déclaration d'un détenu. Ledit comité, après que toutes ses composantes aient été démantelées, considéré comme responsable d'une procédure aussi barbare, a été envoyé sur le front d'Aragon.
En tant que libertaires, nous ne pouvions pas tolérer des procédures aussi néfastes que nous avons toujours combattues. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que notre mission d'enquête et de surveillance ne soit pas critiquée par la population. D'avance, nous savions que ces missions étaient toujours désagréables, surtout pour les ouvriers.
Chaque fois que le temps me le permettait, j'écoutais les émissions de Queipo de Llano de Radio Sevilla. Dans plusieurs de ses émissions, il a prononcé mon nom et du limon est sorti de sa bouche. Lorsqu'il a nommé les patrouilles de contrôle, sa tactique était de mentir, de diffamer, sachant qu'après cela, il restait quelque chose. Il prit soin de dire un seul mot des crimes que la bande des généraux à laquelle il appartenait, commettait quotidiennement avec d'honnêtes Espagnols.
Même ces généraux ont accusé leurs victimes des crimes qu'ils ont commis ou qu'ils ont fait commettre des soldats, fils du peuple. C'était scandaleux d'entendre les assassins parler de Guernica, cette ville basque bombardée et même incendiée par l'aviation allemande à la demande du plus grand meurtrier que le monde ait jamais connu, tristement connu sous le nom de Franco. La franchise n'avait rien à voir avec son nom, tout comme elle n'avait rien à voir avec son frère Ramón, un traître à tous ses camarades aviateurs.
Si Hitler était inhumain, Franco l'était davantage. Celui-là allait semer la mort dans des terres étrangères à l'Allemagne. Franco l'a planté en Espagne où il est né. Il en fit un immense feu de joie, qui continua de brûler au-delà de 1939. Dans les années qui suivirent la fin des combats à l'intérieur, le général despotique continua à ordonner des arrestations, des martyres et des exécutions. Ses instincts étaient si sauvages et envieux que même ses plus proches parents le craignaient. Il n'y avait même pas de général avec l'intention de le remplacer comme dictateur après sa mort, de peur qu'il ne ressuscite.
Lorsque les patrouilles de contrôle ont été formées par le comité de la milice, les délégués à ce comité des partis et organisations qui le composaient ont nommé leurs meilleurs militants pour faire partie des patrouilles, quel que soit leur âge. Lorsque la direction des patrouilles m'a été confiée par le Comité de la Milice, j'ai pris conscience de ma responsabilité devant ledit Comité et aussi devant la Generalitat de Catalogne. Celui-ci devait effectuer le paiement de la mensualité des hommes de Patrouilles, se procurer l'armement et aussi les uniformes. Concernant le port de l'uniforme, il y a eu au départ des protestations d'une minorité. Sans être amateur de le porter, j'ai fait comprendre la nécessité de se distinguer des autres citoyens.
Enfin, il a été approuvé de porter un uniforme et un insigne, à la condition que tous les uniformes soient les mêmes pour moi et pour les responsables des sections. Le salaire était également le même pour tout le monde. Seulement, j'avais un montant plus élevé pour couvrir les frais de voyage et une escorte réduite à cinq hommes. Tous droits et devoirs étant égaux, je ne me suis jamais considéré supérieur de quelque manière que ce soit à mes pairs. Il n'y avait pas d'ordres parmi nous, mais il y avait une obligation de surveiller et de réprimer ceux qui favorisaient les fascistes.
Puisque les sirènes signalaient la présence d'avions ennemis, à l'extérieur de jour comme de nuit, chacun de nous avait le devoir de faire une apparition dans la rue pour surveiller si des signaux lumineux étaient faits aux avions depuis un balcon ou une fenêtre, faciliter l'entrée dans les abris aux citoyens et collaborer avec les ambulances s'il y avait de la place pour cela.
Plusieurs arrestations ont été effectuées, dont certaines étaient sans effet, et plusieurs personnes ont été remises aux tribunaux, prouvant leur appartenance à la Phalange. Trois stations clandestines ont été découvertes: une à Sant Gervasio et deux à Sarria. Nos services les ont localisés en quelques jours. Avec beaucoup de précautions, les propriétaires des tours dans lesquelles ces stations étaient installées ont été arrêtés. Son installation n'était pas récente. Tous les détenus étaient des militaires qui ont pu échapper vivants aux combats qui ont eu lieu les 19 et 20 juillet dans les rues de Barcelone.
Tous les collègues de la patrouille ont été infatigables dans leur travail d'enquête et de surveillance. Les heures consacrées à ce travail ne comptaient pas. Aucune réglementation n'existait dans les patrouilles, mais les hommes qui les composaient étaient des libertariens et des antifascistes qui ont exposé leur vie pour la liberté. Bien sûr, la découverte de fascistes pris en embuscade n'était pas toujours due à des enquêtes.

Chaque jour, des plaintes pleuvaient dans mon secrétariat. Or, les informateurs n'existaient pas dans les patrouilles. Nous les considérions comme des êtres dégoûtants. La plainte a été admise lorsqu'elle a été faite pour servir la cause antifasciste. Le plaignant était détenu s'il pouvait être prouvé que la plainte était fausse.
Mon travail était très gros et je me suis vite senti fatigué. Ma fatigue est venue déjà en prévision du 19 juillet. Je n'avais que 10 tensions. Dans le même cas se trouvait mon collègue García Oliver. Nous étions tous les deux en traitement médical par le docteur Santina.
Pendant ces jours, j'étais intervenu dans la libération d'un des frères Carulla, qui avait été indûment détenu et menacé d'exécution. Le frère aîné du détenu était un médecin généraliste qui était reconnaissant de mon intervention pour la juste liberté de son frère. Conscient que le Dr Santina prenait soin de ma santé, il lui a demandé de veiller à mon rétablissement efficace.
Carulla a pris soin de me faire les injections correspondantes. Comme je n'avais pas d'heures fixes pour que je puisse me retrouver dans mon bureau, Carulla m'a fait les injections à l'endroit où elle me trouvait, parfois impossible. Il ne fait aucun doute que j'ai beaucoup apprécié ses soins. Sans mon rétablissement, il m'avait été impossible de continuer à diriger les patrouilles, puisque j'avais peu d'heures de repos, je ne me couchais pas avant deux heures du matin tous les jours, et la nuit, les avions venaient bombarder Barcelone ou ses environs. .
J'ai été le premier à m'habiller rapidement pour sortir pour montrer l'exemple. C'était mon devoir. Combien de fois j'ai risqué d'être blessé par des éclats d'obus! Cependant, je n'ai jamais pensé à la mort et par conséquent, cela aurait pu me venir, par exemple, dans les premiers jours du soulèvement militaire, au cours duquel tant de bons collègues et amis sont morts.
Le Comité de la milice était composé de l'Esquerra Republicana de Cataluña, Acción Catalana, Rabasaires, Poum, Unión Socialista de Cataluña, U.G.T., C.N.T. et F.A.I. Chacun de ces partis et organisations a désigné un nombre proportionnel de membres. Ceux appartenant à
les C.N.T.-F.A.I étaient les plus nombreux. Pour ma part, étant à la tête des patrouilles, à aucun moment la supériorité numérique du C.N.T. ni n'utiliser aucune coercition contre des individus appartenant à d'autres parties.
Cependant, la grande majorité estimait appartenir à la C.N.T. ou à la F.A.I., sûrement parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de différences entre nous et que les patrons n'existaient pas dans nos cercles, et que la discipline n'était pas imposée. Il n'y avait qu'en nous le devoir de servir la cause de la liberté.
Un problème s'est posé à moi en tant que responsable des patrouilles: il s'agissait de s'assurer que chacun de nous avait une arme pour se défendre. Les rares qui étaient fabriqués à l'intérieur à cette époque devaient être envoyés sur le front d'Aragon, avec les munitions. Une offre m'a été faite par de bons collègues français, qui a été acceptée avec enthousiasme par tous ceux qui m'ont soutenu dans l'organisation des patrouilles.
Il ne fait aucun doute qu’il fallait de l’argent pour acquérir ces armes et ces munitions. Cela pourrait nous être fourni par la Generalitat de Catalogne, à laquelle nous avons remis tout ce qui provenait des perquisitions et des confiscations que nous avons effectuées dans les maisons de fascistes connus, qui, dans les premiers jours du soulèvement militaire, avaient réussi à fuir à l'étranger ou à passer la la Zone de Franco
Tarradellas, conseiller de la Generalitat, à qui nous avons donné tout ce dont les patrouilles avaient besoin, nous a fourni une somme de francs français et suisses. Je ne me souviens pas combien, mais il nous suffisait de faire un premier achat d'armes et de munitions, qui étaient payés une fois l'acquisition faite, car dans ces moments de confusion, de nombreuses déceptions étaient pratiquées. Ainsi, les achats devaient être payés pas avant de recevoir la marchandise et de vérifier si la quantité d'armes et de munitions correspondait à l'achat effectué.
Lors des réunions quotidiennes du comité de la milice, nous avons analysé si ce qui avait été convenu les jours précédents s'était déroulé sans aucun revers. En même temps, nous avons fait une étude de l'actualité qui nous parvient de la zone franquiste et de ce qui a été publié par la presse étrangère en relation avec la marche de la lutte sur tous les fronts.
De la presse étrangère, seule la presse de gauche a raconté les événements qui se déroulaient en Espagne dans la réalité. L'autre presse, celle de droite, l'a fait avec partialité, favorisant les fascistes et même falsifiant les faits, pointant les horreurs commises par les rouges contre les prêtres ou les frères, et leur complicité avec eux n'a jamais été signalée.
les militaires rebelles. Ces fausses nouvelles nous ont scandalisés. Nous ne pouvions rien faire pour les nier. La réalité était que les prêtres et les frères qui ne sont pas intervenus dans la lutte que nous avons eue avec les militaires en ces premiers jours de juillet, ont été respectés.
Le Comité de la milice n'a pas pu éviter des cas isolés commis par des individus incontrôlés, en particulier dans les premiers jours de combats dans la rue. Nous ne pouvions pas non plus éviter les vendettas personnelles qui s'ensuivirent sans aucun doute. Honnêtement, au Comité de la milice, je dois signaler que si l'auteur pouvait être découvert dans un cas dégoûtant, il aurait payé de sa vie.
La lutte qui a eu lieu en Espagne, provoquée par les militaires et les réactionnaires dans les années 1936-1939, a été le prélude à la guerre qui a provoqué le fascisme international de 1939 à 1945. Il faut que les jeunes de cette fin du XXe siècle le sachent.
Nous étions déjà fin octobre et l'apparence du combat avait complètement changé, puisque nous étions face à une armée qui, en plus d'être manœuvrée par des militaires professionnels, avait des armes efficaces et l'aide de l'Allemagne et de l'Italie. Ce dernier, plus tard, a fourni aux franquistes plusieurs bataillons de soldats bien encadrés. Dans notre domaine, nous manquions de stratèges, et surtout d'armes.
Les hommes que nous avions en première ligne méritaient l'admiration de toute l'Europe. Tous de dignes travailleurs qui ont laissé leurs outils de travail pour défendre la Liberté et barrer la voie au fascisme. Celui-ci était déjà bien installé en Allemagne et en Italie, préparant la grande guerre, celle du cœur de Bronze, qui est nécessaire à ceux qui ont créé l'industrie de guerre pour s'enrichir. Ceux-ci sont nombreux dans le monde. Ils sont appelés n'importe comment dans la variété des noms qui incluent ce qu'ils appellent la politique et ceux qui en vivent.
Je n'ignorais pas ce que signifiaient les huit lettres qui composent la «politique», mais la position que j'ai occupée au sein du Comité de la milice de juillet 1936 jusqu'à la dissolution, m'a amené à traiter de très nombreuses années qui avaient évolué d'un parti politique. autre. La question était d'en vivre.

En février 1937, je me suis rendu en France et en Suisse, en compagnie des compagnons qui composaient mon escorte, pour payer l'achat d'armes acquises en Allemagne. L'acheteur de ces armes était un bon camarade français résidant à Genève1.
Nous voyagions dans une voiture Buik, avec plaque d'immatriculation B = 4 = P, modèle 1937. Cette voiture a été achetée par le gouvernement de Catalogne à General Motors et enregistrée à mon nom sur le permis de conduire.
Depuis que nous avons traversé la frontière à Annemasse, en direction de Genève, la police n'a cessé de nous suivre comme notre ombre. Le lieu de rencontre avec le collègue qui avait acheté les armes était un café au centre de Genève. Nous avons garé la voiture devant le café. La police l'a fait sur le trottoir de l'autre côté de la route. Comme nous devions nous rendre à Neufchâtel, j'ai décidé que ma voiture reviendrait en France.
A Lyon, ils ont dû rester à l'hôtel Terminus et y attendre jusqu'à ce qu'ils aient de mes nouvelles. Avec le camarade Espert, celui qui a acheté les armes, et moi, nous sommes sortis du café par une porte qui donnait sur une autre rue et avec la voiture du camarade qui nous avait donné rendez-vous à ce café, nous sommes allés à Neufchâtel. La police n'a sans doute pas réalisé que quatre personnes montaient sur le Buik au lieu de six.
Un accident inattendu s'est produit. Le camarade González, qui conduisait le Buik, ne s'est pas rendu compte qu'à Saint-Julien, le policier suisse a quitté le poste et a sifflé. González a freiné la voiture avec force et comme le sol était gelé, la voiture s'est heurtée à un arbre. Les quatre occupants du Buik ont été blessés. Mateu était sérieusement sérieux. Ils ont été conduits à l'hôpital de Genève, où le consul espagnol, M. Rivas Cherif, s'est aussitôt présenté et a pris en charge les légèrement blessés. Sous sa protection, Mateu, grièvement blessé, diabétique, n'a pas résisté à l'opération. Il est décédé 14 jours après avoir été admis à l'hôpital.

À Neufchâtel, nous nous sommes rencontrés dans une maison privée avec laquelle il devait nous fournir des armes. Après les avoir choisis dans un album et ajusté les prix, il était bien établi que les armes seraient payées en francs suisses après avoir été déposées à Machilly, en France, dans un abri situé en zone franche. Le propriétaire de l'auberge était français et appartenait au Parti socialiste d'Annemasse.
1 Geneve, dans l'original.
2 Beau-frère de Manuel Azaña.
Bien que nous ayons l'argent pour payer les armes et que nous ayons confiance avec le représentant du vendeur, nous avons décidé que le paiement serait effectué lorsque les armes seraient déposées à l'Auberge de Machilly.
Nous avons passé la nuit dans un hôtel de Neufchâtel, ignorant l'accident survenu à nos collègues. De l'hôtel, nous sommes allés à la gare pour prendre le train qui devait nous conduire à Genève. Comme je ne savais pas si nous serions quelques jours à Neufchâtel avant de nous séparer au café de Genève, si je donnerais à mon camarade González mon adresse postale pour l'autre Neufchâtel au cas où nous devions me communiquer quelque chose de Lyon.
Lorsque l'accident s'est produit à la frontière de Saint Julien, c'est lorsque les policiers qui suivaient le Buik ont réalisé que deux passagers manquaient à la voiture - c'est-à-dire notre partenaire Espert et moi-même. Interrogés sur nos allées et venues, tous ont répondu de la même manière: «nous l'ignorons».
À l'intérieur de la voiture, sous les sièges, la police a trouvé quatre pistolets, et dans le portefeuille de González, ma dernière adresse postale, Neufchâtel. Parce que nous sommes entrés dans l'hôtel à deux heures du matin, la police n'a pas trouvé notre dossier dans les hôtels de la ville.
Le lendemain, après avoir terminé notre mission, nous avons décidé de rentrer en France, via Genève et de l'hôtel nous sommes allés à la gare. Avec surprise, nous avons vu dans un kiosque à journaux que deux d'entre eux, en première page, annonçaient l'accident survenu dans une voiture Buik dans laquelle voyageaient des anarchistes espagnols. Notre émotion était grande.
En arrivant au poste, un policier habillé en civil - bien qu'il ne portait aucun signe indiquant sa profession, je l'ai parfaitement reconnu - nous a remis la carte d'identité. Avec des signes, je lui ai fait comprendre qu'il ne comprenait pas. Tout de suite, il nous a montré ses lettres de créance. Nous lui avons présenté le passeport, qui était en règle. Il a appelé un employé, sans doute italien, qui nous a fait comprendre que nous devions suivre le policier, et ils voulaient sûrement nous informer de l'accident, nous l'avons suivi sans regret ce qui allait nous arriver.
Il nous a emmenés à la sous-préfecture du lieu. Là, ils ont fouillé très légèrement notre taille, notre poitrine et notre dos. Ils n'ont pas du tout touché nos jambes. Je portais une ceinture à cartouche avec un pistolet de calibre 6,35 juste en dessous de mon genou, à l'intérieur de ma jambe gauche. J'ai pris soin de signaler cet objet. Sans nous poser la moindre question, ils nous ont dit que
3 Ce paragraphe n'ajoute rien
4 Restaurant, je suppose.
nous avons dû nous rendre dans un autre poste de police pour faire une déclaration. Cela nous a été indiqué par un policier qui parlait assez bien l'espagnol.
La délégation susmentionnée était une prison. Son entrée ressemblait à celle d'un couvent ou d'une maison de prostitution. Sur la porte et au niveau de la tête, il y avait un judas. Grâce à elle, vous pouviez voir qui appelait de l'extérieur. La porte s'ouvrit et nous fûmes conduits dans un couloir sans fin dans lequel au fond se trouvait un bureau avec une table et un meuble qui servait de dossier. Dans ce bureau, nous avons été réservés par la même personne qui nous a ouvert la porte. Lui-même nous a conduits dans une cellule dans un autre couloir.
J'ai tout de suite réalisé que dans cette prison, un seul individu était tout: portier, geôlier et directeur. Nous n'avons pas vu d'autre personne à l'intérieur des locaux, qui bien sûr n'étaient pas grands: rez-de-chaussée et deux étages réduits à très peu de cellules, cinq ou six à chaque étage. Il est à noter que si ce n'est pas le sujero en question qui a préparé la nourriture des prisonniers, c'est sa femme qui l'a fait, puisque lui, sa femme et sa fille vivaient au rez-de-chaussée de ladite prison. J'ai appris tout cela lors de leur libération.
Nous sommes entrés dans cette prison sans aucune explication et complètement au secret, sans voir le geôlier que quelques instants par jour, c'est-à-dire trois fois par jour: le matin, à l'heure du café et quand je me lavais au robinet dans le couloir.
Je parlais à un autre prisonnier dans le couloir, qui était tailleur, travaillait sur une machine à coudre et fabriquait des pantalons. Ceux-ci allaient être livrés par le geôlier dans un atelier de tailleur local lorsque ledit prisonnier les avait terminés. Ce prisonnier, dont j'ignorais le nom, m'expliqua qu'il avait été détenu pour avoir conservé le montant d'une facture de 300 francs suisses que son employeur lui avait donné à percevoir. Il en avait besoin pour épouser une fille qui était serveuse à l'hôtel L 'Ecu à Genève.
Je ne sais pas pourquoi le geôlier lui a permis de travailler dans ce couloir. Au début, je pensais que c'était un confident du geôlier, mais j'ai réalisé que j'avais tort car il n'y avait pas d'autres prisonniers dans cet appartement que lui et moi.
Le troisième jour de mon séjour dans cette cellule, vers 20 heures, j'étais déjà allongé sur la couchette, sur un matelas dont je n'ai pas encore pu savoir de quoi il était fait, et je pensais toujours à la raison de mon arrestation, dans le L'état de mes collègues blessés et au cours des événements en Espagne, je commençais déjà à m'endormir. En ce moment, j'ai entendu le sifflet air de la chanson "Rouge et Noir est le drapeau communiste libertaire", qui venait de la rue. Cela me semblait être un rêve. La fenêtre à barreaux de fer dans ma cellule était située au niveau d'un toit de tuiles, et face à une rue que l'on ne voyait pas bien, car il y avait un arbre avec certaines de ses branches posées sur le toit.
D'un bond je fixai mes mains sur les barreaux de la vitre, et en sifflant, je continuai l'air de la chanson. Tout de suite, j'ai entendu la voix du collègue qui nous avait quittés la veille, José. Instantanément, je ne pouvais penser à rien d'autre à lui dire si ce n'était de venir le lendemain à la même heure.
Le lendemain, quand le geôlier m'a ouvert la porte, il m'a dit d'un ton autoritaire: «Attention pas de marchant torero» (il a pris la chanson pour un paso doble). Il a ensuite ajouté que s'il le répétait, il m'enfermerait dans un donjon dans les sous-sols. Je lui ai fait comprendre d'un geste qu'il ne comprenait pas le français. A partir de ce moment, je n'ai plus pensé à autre chose qu'à ce que je dirais demain à mon partenaire et comment je le ferais.
Soudain, une idée m'est venue à l'esprit: faire passer le message par la fenêtre. Mais pour atteindre mon objectif, j'avais besoin d'une pomme de terre qu'ils me donnaient à manger, cuite et non pelée. Par chance, le lendemain, ils m'ont donné des ragoûts.
Pendant le repas, la porte de la cellule a été laissée ouverte pendant une demi-heure, pour permettre de laver l'assiette après avoir mangé au robinet dans le hall où je me suis lavé le visage le matin. J'ai demandé au jeune prisonnier qui travaillait dans la salle un crayon et une feuille de papier de son cahier, qu'il m'a laissé sans demander aucune explication.

Sur les cinq pommes de terre qu'ils m'ont données, je n'en ai pas mangé. Je suis resté parmi les plus gros. Des autres, j'ai découpé des morceaux de dimensions différentes à travers les barreaux de la fenêtre, pour voir où ils arrivaient au-dessus des tuiles. La distance séparant la clôture du bord du toit faisant face à la rue était d'environ cinq mètres. Certain que la pomme de terre atteindrait les mains du partenaire quand il viendrait, je me suis retrouvé à méditer le texte du message.
Notre détention et notre détention au secret ont été arbitraires, c'est pourquoi j'ai décidé de payer les autorités suisses avec la même monnaie. J'ai dû sortir de cette situation. J'avais les nerfs à vif car je ne savais rien de la Catalogne ou de l'Espagne.
Le message que j'ai envoyé à Aurelio Fernández se lisait comme suit: «A la réception de ce message, je vous prie de détenir d'abord le directeur d'Hispano Suiza, M. Braget. 2e parmi les quelques Suisses vivant à Barcelone, à l'exception du consul. J'espère qu'après ces arrestations, je verrai le visage du juge. " J'ai terminé le message en demandant au collègue de se rendre à Barcelone après avoir obtenu le billet d'avion par l'intermédiaire du consul espagnol à Genève, M. Ribas Cherif, mais sans lui parler du message que j'ai mis à l'intérieur de la pomme de terre.
Dans un trou que j'ai fait, j'ai enroulé la pomme de terre avec ma pochette et j'ai attendu l'arrivée du compagnon, l'oreille fermement contre la grille. Après la tombée de la nuit, j'ai entendu des pas dans la rue puis la voix du camarade qui m'appelait. Je lui ai jeté la pomme de terre enveloppée dans le mouchoir et lui ai dit: "Prends ça." Il descendit la rue à grands pas.
Cela s'est produit jeudi après-midi. Les arrestations ont eu lieu vendredi. Le samedi matin à 10 heures, le geôlier est venu m'informer qu'une demi-heure plus tard, le juge viendrait. Samedi, en Suisse, les fonctionnaires ne travaillent pas. La présence du juge en prison ce jour-là était une exception très rare. Cela m'a conduit à supposer qu'à Barcelone, les personnes que j'ai mentionnées dans le message adressé à Aurelio Fernández ont été arrêtées.
Conduit à une grande salle d'audience, je me suis retrouvé devant un juge et trois avocats ou magistrats et un interprète qui ont traduit pour moi la question du juge, que j'avais comprise: "Où sont les armes?" "Je ne sais pas de quoi vous parlez". "Cependant, vous êtes venu à Neufchâtel pour les acheter." «Si je suis venu en Suisse, c'est avec l'intention d'acheter du lait concentré pour les personnes âgées et les enfants de Catalogne. Comment voulez-vous que j'entende acheter des armes en Suisse, où il n'y a qu'une seule usine d'armes, la Manufacture nationale de Berne? " A ma réponse, il a immédiatement changé le disque et a annoncé l'arrestation à Barcelone de M. Braget, un Suisse accusé d'espionnage et en danger d'être abattu.
"Le Président de la République Helvétique a téléphoné à M. Lluis Companys, et il a répondu que M. Braget avait été détenu par les patrouilles de contrôle et que vous seul pouviez interférer avec sa liberté" J'ai répondu: "Je suis désolé mais je ne le suis pas Je n'interviendrai jamais dans la libération d'un espion. " Mes mots sont tombés comme une bombe dans la pièce. Le juge a sauté du fauteuil et a déclaré: «M. Braget n'est pas un espion, il est millionnaire et il n'a pas besoin de faire de l'espionnage. Si quelque chose de grave devait lui arriver, pensez que vous êtes entre les mains de la justice suisse. " En entendant ces mots, je suis allé voir l'interprète et lui ai demandé de traduire les paroles du juge pour moi. Il l'a fait.
S'adressant au juge, j'ai dit: «Malgré vos menaces, je répète qu'en temps de paix, comme en guerre, des espions sont fusillés, et s'il y a justice en Suisse, je ne le ferai pas
il peut tirer, car je ne suis ni un espion ni un voleur et ils m'ont détenu pendant douze jours5. Aussi mon partenaire, les deux au secret. Nous sommes venus en Suisse avec un passeport légal, approuvé par le consul suisse à Barcelone. Comment voulez-vous que je signe la liberté de M. Braget à mille kilomètres de là? N'attendez pas de moi cette signature si demandée, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec le détenu et m'emmènent dans la cellule, ma présence ici est inutile. "
L'interprète lit ma déposition dans un silence absolu dans la salle. Après la lecture, le juge est parti. Il est revenu une dizaine de minutes plus tard et a déclaré: «Par la volonté expresse du président Mota, je décrète la liberté et celle de son partenaire. Je vous autorise à le communiquer au Président Companys par téléphone. " Je l'ai fait instantanément, sans lui donner un autre slogan.
L'ordre a été donné au directeur de la prison de nous libérer immédiatement. Je me suis opposé à l'idée de sortir le soir et leur ai dit: "Nous partirons demain matin en compagnie du consul d'Espagne à Genève." Le geôlier, très attentif et très différent de ce jour où il avait entendu la marche taurine, m'a dit qu'il ne passerait pas cette nuit dans la cellule, qu'il me ferait préparer un lit dans une chambre de son appartement, et que nous mangerions ensemble avec mon compagnon, même si pour lui il n'y avait pas d'autre lit disponible. J'ai eu l'impression de dormir dans le lit de sa fille.
Pendant le dîner, nous parlions du soulèvement militaire en Espagne, mais il ne nous a pas dit quelle était son opinion.
5 La première fois qu'ils sifflent, c'est le troisième jour. Celui avec le message le quatrième (jeudi) donc samedi devrait être le sixième. (Fin du texte)


PRÉFECTURE DE POLICE
Paris le 10 juin 1939
Le Préfet de Police à Monsieur le Ministre de l’Intérieur
Comme suite à votre circulaire n°78 du 15 mars 1939 j’ai l’honneur de vous faire connaître que le nommé ASSENS José, né le 11 juillet 1900, de nationalité espagnole, a été infructueusement recherché dans le département de la Seine.
Cet étranger a été signalé comme ayant assumé les fonctions de « chef général des Patrouilles de Contrôle » à Barcelone et comme ayant fait exécuter sans jugement de nombreux compatriotes suspects de sympathies pour le Général Franco.
Il est tenu en observation.
Quant à l’individu disant s’appeler DUE et connu comme « chef de service des informations anarchistes », il n’a pu également être retrouvé et le défaut d’éléments d’état-civil n’a pas permis d’effectuer les recherches d’usage dans les services administratifs.
Le préfet de Police.
José Asens est interpellé le 11 décembre 1939 à Villeneuve-sur-Lot.
Il montre un récépissé délivré par la mairie d’Ambilly le 16 octobre 1937 et un laisser passer-sauf conduit délivré le 28 octobre 1939 par la gendarmerie de Montpellier pour se rendre à Villeneuve-sur-Lot.
11 décembre 1939
BIANSAN Louis, Inspecteur
7 Bordeaux
(…) Procédant ce jour au contrôle des étrangers dans la commune de Villeneuve sur Lot, avons interpellé afin qu’il nous présente ses pièces d’identité au fin de contrôle.
(…) Nous interrogeons ASSENS GIOL comme suit qui déclare (…) :
« Je me nomme ASENS GIOL et non ASSENS GIOL, prénom José ; je suis né le 11 juillet 1900 à Barcelone – Espagne ; fils de José et de Pilar GIOL, ex-chef de la police de la Généralité de Barcelone, dans cette ville ; je suis marié à VALERA Amelia depuis 1920 à Barcelone ; j’ai quatre enfants, je sais lire et écrire le français. Jamais condamné.
Je suis en France depuis 1937.
En Espagne à Barcelone, j’ai exercé la profession de Chef de la Police pour toute la Généralité. J’ai été nommé par décret-loi de ce Gouvernement le 20 ou le 21 juillet 1936. J’ai exercé mes
fonctions pendant un an environ.
En 1937 par ordre du Ministre de l’Intérieur de la Catalogne, j’ai reçu pour mission celle de venir en France afin de me rendre compte de la façon dont fonctionnait le service d’Aide aux Espagnols au point de vue ravitaillement – à cette époques les vivres venaient de France par convois routiers et ferroviaires.
La première fois que je suis entré en France, vers octobre ou novembre 1936, j’étais titulaire d’un passeport – que j’ai égaré depuis – qui m’avait été délivré par la Direction de la délégation de l’Etat espagnol.
J’ai traversé la frontière par le poste de Cerbère. A mon passage le service de police du poste frontière a visé ou plutôt timbré mon passeport.
Je suis revenu en Espagne après ma première mission et par la suite à différentes dates je suis revenu en France, où je séjournais 7 à 8 jours.
Je circulais en France en automobile. J’ai eu plusieurs voitures à ma disposition qui m’étaient fournies par mon service. J’ai circulé également avec ma voiture personnelle immatriculée B4P (qui veut dire « Barcelone n°4 provisoire »).
J’ai ainsi accompli diverses missions jusqu’au mois d’août 1937.
A cette époque je suis entré définitivement. J’étais toujours titulaire du même passeport portant un récent visa.
C’est à la suite d’une insurrection en Catalogne où les pouvoirs ont été pris par le Gouvernement espagnol dont allait dépendre les services dont j’étais le chef que j’ai pris la résolution de quitter l’Espagne. J’avais compris que mes fonctions n’allaient plus être contrôlées par la Généralité de Catalogne, mais par ce nouveau Gouvernement à tendance communiste dont je ne voulais pas que mes actes soient contrôlés.
J’ai donc abandonné mon poste pour me réfugier en France. Le Gouvernement de Catalogne qui assurait encore la direction de la province m’a fait libeller un visa sur mon passeport afin que je puisse entrer à nouveau en France.
C’est donc en août 1937 à une date que je ne puis fixer que j’ai traversé la frontière où j’ai été conduit par une voiture automobile de la Généralité. Je suis à nouveau entré par Cerbère accompagné cette fois de mon secrétaire Miguel GONZALES BATLLE et FABREGAS Tomas. L’un a rejoint la Belgique, le deuxième le Mexique depuis.
A mon entrée en France après avoir accompli les formalités de passage je me suis rendu à Perpignan où j’ai logé au Grand Hôtel pendant une dizaine de jours. Puis je suis parti pour Paris où j’ai logé à l’hôtel de Comodore, boulevard Haussmann pendant deux mois.
A Paris, je n’ai pas travaillé. J’ai fréquenté mes compatriotes qui m’ont aidé pour vivre dans la capitale et notamment MM. TARADELLAS, Conseiller des finances de Catalogne, M. FECED Ministre de l’intérieur de Catalogne, M. AIJUADEZ, Ministre de l’Instruction publique au Gouvernement de Madrid, tous faisant partie du groupement de gauche de Catalogne et réfugiés en France, ainsi que d’autres compatriotes dont j’ignore les noms.
Après deux mois de séjour à Paris, je suis parti à Bruxelles où j’ai habité dans un hôtel dont je ne me souviens plus le nom mais se trouvant auprès d’une grande place.
Je suis sorti de France avec mon passeport par le poste frontière de – je ne me souviens plus – j’avais pris le train à la gare du Nord à Paris.
En Belgique je ne me suis livré à aucune activité pas plus qu’en France.
A Bruxelles je me suis présenté au Consulat espagnol pour faire des démarches afin d’obtenir mon séjour dans cette ville. Avant d’avoir obtenu satisfaction et après un séjour dans cette ville d’un mois environ je suis revenu en France en passant la frontière par le poste de l’aller où je me suis présenté avec mon passeport aux autorités françaises. Ce document était visé par le consul de Belgique et le consul de France ; j’avais obtenu ces visas pour une durée de séjour en France dont je ne me souviens plus.
Je suis revenu à Paris où je suis descendu à l’hôtel Rochester, rue de la Boétie où je suis resté quelques jours seulement ayant décidé d’aller rejoindre une famille amie dans la commune d’Ambilly (Haute Savoie).
Je savais que dans cette localité je rencontrerai la famille Conrad Guardiola, commerçant en fruits et légumes, 14 rue A. Briand.
A Ambilly j’ai obtenu la délivrance du récépissé que je vous représente avant que le délai de séjour accordé par le visa du Consul soit expiré.
La profession existant sur ce document a été portée ainsi que mon état civil au vu du passeport que j’ai présenté au moment de la demande de permis de séjour.
Dans cette localité je faisais rien, je vivais chez les époux Guardiola chez qui je suis resté jusqu’au 10 mars 1939 date à laquelle je suis revenu à Paris pensant y rejoindre ma femme et ma fille qui avaient été évacuées et qui pouvaient avoir obtenu mon adresse dans la capitale.
Le 18 mars je débarquais à Paris et je logeais 22 rue Vilin. Là j’ai fait la connaissance avec plusieurs compatriotes réfugiés comme moi et dont je me rappelle plus le nom.
Quelques mois après, ayant obtenu l’adresse de deux de mes enfants à Mauriac (Cantal) où ils étaient réfugiés, j’ai quitté Paris pour aller les chercher. J’ai obtenu l’autorisation de M. le Préfet du Cantal pour amener les enfants avec moi.
Je ne suis pas revenu à Paris et je me suis rendu dans la commune de Vendémian (Hérault) avec eux pour travailler aux vendanges. Nous avons vendangé chez deux propriétaires M. Roques et Hérault du 24 septembre au 24 octobre 1939.
Par la suite je me suis rendu à Montpellier avec mes enfants où je suis resté huit jours environ, je logeais dans un petit hôtel. Dans cette ville j’ai reçu des nouvelles de ma femme et de ma fille Rosita qui se trouvaient à Bias (Lot et Garonne).
Aussitôt je suis parti pour cette commune où j’ai retrouvé mon épouse et ma fille. En arrivant le 3 novembre 1939 à Bias j’ai fait viser mon récépissé par la mairie.
J’ai trouvé en location une petite maison où je me suis installé, avec ma famille. Je travaille depuis mon arrivée. J’ai été occupé aux travaux de la nouvelle poudrerie à Ste Livrade et depuis huit jours je travaille chez M. Nouvel, marchand de meubles à Villeneuve.
Depuis que je suis en France je me suis toujours comporté comme un étranger en exil sans me livrer à un acte répréhensible quelconque ; je n’ai pas fait de politique, ni de propagande. Je ne suis en relation avec aucun groupe politique quelconque.
A Paris, j’ai bien consulté les services de l’émigration des Républicains espagnols (SERE) mais c’était pour obtenir pour ma famille et pour moi le passage pour gagner le Mexique ou un autre pays sauf l’Espagne.
Ma seule préoccupation en France a été celle d’arriver à rassembler tous les membres de ma famille réfugiés un peu partout.
SNI – j’ai un fils qui a été interné au camp de Bram ((Aude) qui se trouve actuellement chez M. Perron, propriétaire aux environs de Fontainebleau. Il se nomme José, est né le 7 mars 1922 à Barcelone.
Mon père, José, âgé de 63 ans, fils de Blas et de Lucia Lliado, profession tapissier, ayant résidé en Espagne à Barcelone 160 rue Llobregat, se trouve actuellement interné au camp de Bram (Aude).
SNI – Ma femme et ma fille réfugiées à Beauvais ont quitté cette ville pour me rejoindre à Paris, où elles ne m’ont pas trouvé. Elles ont quitté la capitale à la suite d’un ordre prescrivant à tous les étrangers de quitter Paris et sont venues avec des compatriotes habiter à Bias (Lot et Garonne) où je suis venu, comme je l’indique plus haut les rejoindre le 3 novembre dernier.
SNI – Vous venez de me donner lecture du libellé d’une circulaire par laquelle je suis signalé comme ayant commis de nombreux assassinats en Espagne et comme étant le Chef d’une patrouille de « Pistoléros » contrôlée par la FAI. À cela je réponds que c’est inexact. J’étais le chef de la police de Catalogne, c’est tout. Je n’ai pas autre chose à déclarer.
SNI – En effet je n’ai pas fait viser mon récépissé à mon départ de Paris lorsque je suis allé à Mauriac chercher mes enfants. Si ce visa de départ ne figure pas sur ce document, c’est que je ne suis pas revenu à Paris ayant travaillé dans le département de l’Hérault aux vendanges.
A Montpellier la Gendarmerie m’a délivré un sauf conduit au vu de mon récépissé le 28 octobre 1939 pour me rendre à Villeneuve sur Lot sous le n° 4921. Ce document était valable du 29-10-1939 au 5-11-1939. J’ai obtenu ce sauf conduit appuyé également par un certificat de résidence à Paris délivré par le Commissariat du quartier de la rue Vilin.
Comme vous le constatez depuis que je suis en France je ne me suis jamais caché et je me suis soumis à toutes les obligations des étrangers résidant en France.
13 décembre 1939. Notification de l’internement au camp du Vernet de José Asens Giol.
Son père, José Asens Llado, se trouve au camp de Bram.
Extrait interrogatoire de ce dernier, 4 janvier 1940 :
« Je n’ai plus vu mon fils depuis environ deux mois avant l’exode. Par la suite, j’ai su qu’il était à Paris et qu’il cherchait à rentrer au Service d’évacuation des réfugiés espagnols (SERE). Il m’a envoyé quelques lettres au Camp de Bram et dans une de ses dernières lettres il m’informait qu’il travaillait aux vendanges, mais je ne me souviens plus dans quelle région. Dans sa dernière lettre il me disait qu’il allait à Montpellier, je lui ai écrit, mais ma lettre ne lui est pas parvenue et m’a été retournée. Depuis je n’ai plus de nouvelles de mon fils. »

En France il fut envoyé dans une compagnie de travailleurs étrangers pour travailler au barrage de l’Aigle dans le Cantal. C’est là qu’avec un noyau de compagnons, dont J. Berruezo et José German, il participa à la réorganisation clandestine de la CNT pendant l’occupation. En novembre 1941 il était membre du Comité de relations de la CNT du barrage. Lors du plenum clandestin tenu à Mauriac (Cantal) en juin 1943, il fut nommé comme secrétaire du comité de relations du MLE en exil dont les autres membres étaient J. Berruezo et J. German. Son fils José Asens Valera était l’un des 75 espagnols intégré dans une compagnie du Bataillon Didier au barrage de l’aigle (voir Juan Montoliu del Campo voir la Page)
Engagé volontaire dans l'Armée Française 23e BMVE
depuis
le 08 Mai 1940
https://journals.openedition.org/ccec/3285
La famille résidait 5 rue de l'Egalité à Mauriac (Cantal)